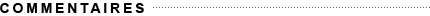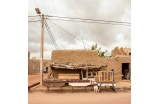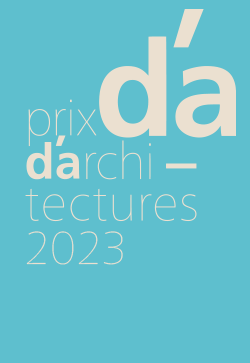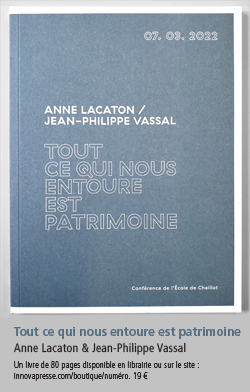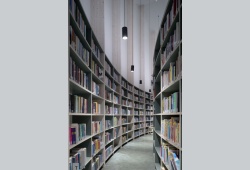Je n’ai pas été particulièrement surpris
lorsque le prix Pritzker d’architecture a
annoncé son dernier lauréat. Après tout,
le prétendu prix Nobel de l’architecture
a l’habitude d’alterner entre les chouchous des médias de renommée mondiale,
comme Philip Johnson ou Rem Koolhaas,
et des personnages plus régionaux, comme
Glenn Murcutt ou Sverre Fehn. Les candidats africains qui pourraient avoir
mérité le prix au cours de ses quarantetrois ans d’existence n’ont pas manqué.
L’influence de l’architecte égyptien Hassan
Fathy (1900-1989) sur les démarches alternatives contemporaines n’a pas encore été
pleinement reconnue, et David Adjaye
a été finaliste à plusieurs reprises. Après
la Grande Récession de 2008, le monde
architectural s’est efforcé de racheter ses
excès. On pourrait interpréter l’exposition d’Andres Lepik au MoMA en 2010,
« Small Scale, Big Change : New Architectures of Social Engagement », qui mettait
l’accent sur les projets destinés aux communautés défavorisées, comme une tentative de rédemption. Il est fort probable
que les futurs jurys Pritzker choisissent des
candidats parmi ceux qui ont participé à
cette exposition. Sur les douze architectes
présentés dans l’exposition, trois ont déjà
été sélectionnés, dont le lauréat de cette
année, Diébédo Francis Kéré.
lE rEgArd tourné vErs lE sud
Ce n’est pas la première fois que des architectes occidentaux tournent leur regard
vers l’Afrique en temps de crise. Le critique britannique Reyner Banham (1922-
1988), par exemple, estimait que les architectes ignoraient le progrès technologique
effréné de son époque. En guise de provocation, son livre The Architecture of the WellTempered Environment (1969) imaginait une
gestion de l’environnement remplaçant
le besoin humain d’abri et s’inspirait des
constructions africaines. Pour un public
habitué aux images de l’exposition « The
Family of Man » (1955) d’Edward Steichen
et de l’ouvrage Architecture Without Architects
(1964) de Bernard Rudofsky, les exemples
« d’une architecture autre » étaient nombreux. « Les sociétés qui ne construisent
pas de structures substantielles, écrit
Banham, regroupent leurs activités autour
d’un ...(