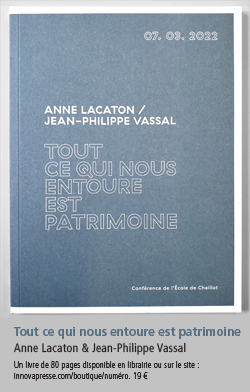Pour les bidonvilles en France
Rédigé par Pascale JOFFROYPublié le 01/10/2015
 Photographies issues de la série Wasteland de Myr Muratet |
La norme fabrique l’exclusion et scelle l’inhospitalité. Au moment où l’accueil des migrants interroge frontalement la disponibilité immédiate de logements, le bidonville continue d’être stigmatisé et systématiquement démoli en France. Qu’il puisse être respecté et admis comme habitat provisoire, sas d’entrée ou refuge de situations atypiques résiste à nos pensées bétonnées du standard, du long terme, du confort individualisé et de la ville « moderne ». Entre le cynisme installé d’une « ville générique » où rien ne serait possible et les solutions messianiques remises à demain, nous pourrions plutôt interpeller concrètement un changement de statut pour les quartiers autoconstruits, leur trouver espace et temps dans la fabrique planifiée de nos villes, apprendre à leur être utiles dans nos pratiques d’architectes. |
Le bidonville explose partout dans le monde et représente plus du tiers des citadins de la planète. ONU-Habitat récuse depuis vingt ans les politiques d’éradication et appelle à respecter cet habitat, à le considérer comme un processus urbain utile et à l’améliorer. En France pourtant, le bidonville reste ignoré et refoulé par les politiques urbaines. Il est systématiquement détruit au mépris des droits de l’homme et méprisé comme sujet d’architecture. La Dihal (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) recense environ 500 « campements illicites » dans l’Hexagone, termes qui selon l’ONU suffisent à les désigner comme bidonvilles. La France applique leur expulsion-destruction systématique à un rythme qui s’amplifie et détient probablement l’un des meilleurs scores mondiaux d’efficacité en la matière. Sur le sol français, la vie en bidonville est l’une des plus instables et donc l’une des plus difficiles du monde. Les Roms, citoyens européens, sont numériquement les premières victimes de cette politique rarement débattue, mais d’autres occupants de terrain – français, réfugiés, immigrés, gens du voyage, SDF, travailleurs précaires – subissent dans l’indifférence cette chasse à la visibilité publique, sans parler des « camps » officiels de migrants en transit, régulièrement déplacés. Face au prix humain et matériel de la démolition des bidonvilles, à l’instabilité du domicile et à l’errance territoriale qu’elle produit, il faut regarder pour ce qu’elle est la politique française de « résorption », vieil avatar de la tabula rasa : sur le plan politique, une maltraitance humaine dissimulée derrière de faux remèdes ; sur le plan juridique, le mensonge institutionnalisé d’une obligation de détruire et un manquement à nos droits fondamentaux ; sur le plan technocratique, l’emballement destructeur d’une vision normative de l’habitat ; sur le plan urbain, la soumission à une vision ségrégative de la ville et le rejet quasi institutionnalisé des plus faibles ; sur le plan architectural, l’absence de réflexion et de propositions sur le mal-logement, notamment celui de la grande vulnérabilité sociale et de l’immigration. L’importance du sujet grandit avec l’amplification des migrations et l’instabilité croissante des parcours de vie. L’actualité des migrants met en évidence ce constat simple : le logement devient durablement un goulot d’étranglement pour l’ouverture des frontières, peut-être même le noeud du problème, loin devant le marché du travail. Clairement, les possibilités d’accueil butent sur l’inertie de l’offre de logement à court et moyen terme, la lenteur de son extension et sa faible plasticité d’évolution. Les effets d’annonce et efforts ponctuels n’abusent personne. On crée ici une « jungle », là quelques hébergements temporaires, on aménage dix conteneurs, et dans le même temps on expulse par centaines des occupants de terrains. Si l’on veut être moins coupable de nonassistance à personne en danger – pour les nouveaux venus comme pour ceux dont on détruit le fragile habitat –, il faut changer de paradigme. C’est pourquoi il faut avoir le courage de se demander, alors que nos « capacités d’accueil » sont discutées à Bruxelles, si le bidonville pourrait être pris en considération comme habitat possible, accepté, au lieu d’être discriminé et détruit, amélioré et même encouragé ? Il ne s’agit pas d’idéologiser le bidonville ni de prétendre que ses conditions de vie sont bonnes – elles ne le sont pas. Mais de reconnaître en France comme ailleurs sa valeur d’habitat et sa fonction dans la justice sociale. Défendre son existence n’est pas pérenniser la pauvreté – elle se pérennise très bien toute seule –, mais la considérer.
FAUX PROCÈS, FAUSSES SOLUTIONS
La réflexion sur le bidonville en France restant au point mort depuis sa réapparition à la fin des années 1980, il ne faut pas s’étonner de voir l’aspect répressif du sujet écraser, dans les opinions comme dans les faits, toute hauteur politique. Pour la majorité des Français, le sujet se réduit à l’illégalité des occupations de terrain, justifiant automatiquement les destructions. Cette conviction n’est pas seulement réductrice : elle est fausse. Dans la plupart des cas, les expulsions-destructions sont contraires au « respect de la vie privée et familiale et du domicile », inscrit dans les droits français et européen1, au point que l’Europe vient d’imposer aux juges français en charge des dossiers d’expulsion un examen de proportionnalité entre ce respect du domicile et le droit de propriété2. Cet examen élargit théoriquement les possibilités d’existence du bidonville mais n’est pas respecté. On brandit à la place l’argument de l’insalubrité, pourtant fabriqué de toutes pièces par le refus de fournir de l’eau potable et d’assurer le ramassage des ordures ménagères, comme la loi l’impose aux maires. De même, l’insécurité des personnes est entretenue puis utilisée à charge. Arpenter le bidonville, c’est découvrir à quel point l’exclusion se construit. Le devoir « d’hébergement et d’insertion », inscrit dans la circulaire Valls du 26 août 2012 pour pallier la gravité des expulsions (y compris hivernales) et aider au rebond des trajectoires personnelles, n’est qu’un faux-semblant inefficace. Ni les hôtels sociaux lointains et sans cuisine, réservés à quelques-uns pour des séjours courts, ni les quelques villages d’insertion ouverts temporairement aux personnes les plus « aptes », ni les logements vacants des régions dépeuplées qu’une convention signée entre le ministère du Logement et Adoma prévoit d’occuper en vue de « résorber les bidonvilles » ne sont des solutions ciblées et réalistes. Elles entretiennent seulement la fiction d’un État puissant dont la protection justifierait la destruction des bidonvilles, alors même que leurs habitants sont les premières victimes d’un droit au logement opposable inappliqué. La fiction opère : « il n’y aurait qu’à » construire plus d’hébergements et plus de logements sociaux. Les dispositifs d’urgence mobilisés à la fin de l’été 2015 pour répondre à ce qu’on appelle « la crise des migrants » jouent des mêmes leurres. On nous assure que les solutions d’hébergement existent, alors qu’elles sont saturées. On prévoit de mobiliser des logements vacants, mais à quelle échelle et pour quel coût ? On évoque une politique du logement à regonfler, mais où en est-elle ? Si quelques arrangements ponctuels voient le jour, la question reste ouverte pour la grande majorité. Menacé par une paupérisation durable, l’État aujourd’hui défend davantage les « inclus » que les « exclus » : très pauvres, précaires, demandeurs d’asile, marginalisés de tous bords. Ils n’auraient même pas droit au bidonville ?
NORMES ET STIGMATISATION
Zygmunt Bauman, dans Vies perdues, la modernité et ses exclus, soutient que l’État, à mesure qu’il perd ses moyens d’agir, compense sa perte de légitimité et de souveraineté en amplifiant ses fonctions de contrôle par la construction d’une « idée pressante de l’ordre ». Il devient policier à hauteur de son incapacité. La dimension matérielle de ce contrôle s’exerce notamment par une surenchère de normes déterminant les contours d’une conformité dont la puissance publique construit les règles. L’habitat et la ville sont un champ privilégié de cette mise au pas. Exagérant à peine, on dira que moins l’État sait résoudre la crise du logement, plus il fait appliquer des normes d’une conformité stricte et détruit ce qui n’y répond pas. Le bidonville est touché par les deux bouts par ce cadrage. D’un côté, il doit être démoli pour nonconformité, de l’autre, il ne pourrait être remplacé que par des logements sociaux normés (ou dérogatoires à la marge), donc chers, dont la construction à l’échelle des besoins est reportée sine die. Ainsi, la légitimité de détruire devient plus grande que celle de (re) construire. L’expulsion dans une main, l’urbanisme dans l’autre, les maires se prêtent sans faiblir à l’application de cette politique. Pour les acteurs de la ville, le bidonville n’est plus aujourd’hui un problème à prendre en charge par la collectivité mais une anomalie à effacer. À l’égard des immigrés, la vie en bidonville tourne au grief : s’ils ne peuvent pas se loger, pourquoi viennent-ils ? L’évolution est significative. Avant d’être « résorbés », les bidonvilles d’autrefois étaient d’abord tolérés. Il y eut des bidonvilles dans Central Park pendant la Grande Dépression, des bidonvilles arméniens sur des places de banlieues françaises des années 1920, 89 bidonvilles recensés en région parisienne dans les années 1960. Le relogement précédait la « résorbion », du moins du temps était donné. Aujourd’hui, la destruction est expéditive et sans remplacement. Peu à peu, les politiques urbaines se sont affirmées comme des procédures de normalisation spatiale, délaissant la question des plus démunis pour une ville « sécurisée », standardisée « par le haut », gardienne des droits acquis d’un nouvel « entre soi » cousin des « résidences fermées » américaines et sud-américaines. Autant, écrit Jacques Donzelot dans La ville à trois vitesses, l’injustice urbaine résultait autrefois d’une logique de confrontation et de rapports de domination, autant elle relève plutôt aujourd’hui d’une « logique de séparation », d’un « urbanisme affinitaire ». On voit le rejet des bidonvilles se durcir à mesure que les villes font commerce de « garantir » un standing de vie pour leur population cible : plus encore que dans les villes-centres saturées, les expulsions- démolitions tournent à l’obsession dans les banlieues gentrifiées et les secteurs non aedificandi des grandes périphéries, qui construisent leur image de marque par des ZAC programmées à vingt ans et des espaces publics paysagers, bien sûr « partagés ». L’« urbanisme dépolitisé » que pointait Françoise Choay s’est mué en système conservateur, voire moralisateur, un « catéchisme pour technocrates » disait Henri Lefebvre, qui relevait déjà les risques du glissement d’un urbanisme de projet vers un urbanisme de règles. Pour Philippe Genestier (Espaces et sociétés n° 73), l’urbanisme technocratique « s’est référé à une image-idée schématique du bien et de l’efficace, pour l’opposer à une image-idée tout aussi schématique du pathogène et du dysfonctionnement ». Le bidonville est l’image même de ce dysfonctionnement, à la fois ennemi et repoussoir de la bonne conscience normative qui porterait le progrès.
UN SUJET D’ARCHITECTURE
Ce progrès idéologisé serait la motivation principale des adversaires « bien-pensants » du bidonville. Il semble aussi à la source du refus d’interférer de beaucoup d’architectes, bâtisseurs de l’avenir meilleur, tandis que d’autres appuient leur distance prudente sur la phrase de Rem Koolhaas « il est illusoire de prétendre changer la société par l’architecture ». Bernardo Secchi affirme l’opinion inverse dans La ville des riches et la ville des pauvres : « L’hypothèse que je défendrai ici […] soutient que l’urbanisme doit répondre de responsabilités majeures et bien définies dans l’aggravation des inégalités et que toute politique qui cherche à les éliminer ou à les combattre doit prendre le projet de la ville pour point de départ. » Prendre la ville comme système actif et responsable, explique Secchi, renvoie à la capacité de déconstruire les systèmes qui « conceptuellement et opérativement » conduisent vers l’aggravation des inégalités. Le progressisme architectural a accueilli toute une constellation de concepts qui entrent ici en jeu, tels que le rationalisme, le modernisme, le productivisme, l’étatisme, l’hygiénisme, le technologisme, l’individualisme. Pour accueillir d’autres urbanités présentes, il faudrait lutter contre l’urbanisation à finalité normative ou progressiste, affirmer que le but n’est pas de produire « la » ville comme un modèle que la profession elle-même aurait bien du mal à définir comme un choix collectif. Le bidonville des années 1960-1970 a nourri une lecture en contrechamp des principales doxas de la ville et du logement. Au coeur des Trente Glorieuses, il portait une charge de subversion et une remise en cause frontale de l’ordre dominant. En réaction mondiale contre l’excès rationaliste de l’architecture moderne, il apparaissait comme un lieu d’urbanité, en capacité de gestation rapide et de qualités collectives immédiates. L’autoconstruction anonyme et spontanée était légitimée comme un lieu de rapport intuitif à la construction, relayée par des utopistes comme Ivan Illich. Hassan Fathy proposait son Construire avec le peuple, John FC Turner voyait dans le bidonville une planche de salut et Yona Friedman l’avenir de l’humanité, dans un contexte de pauvreté grandissante et d’épuisement des ressources naturelles. Ce foisonnement de réflexions se poursuit aujourd’hui dans les recherches sur la ville informelle (Riken Yamamoto), l’autoproduction et la gestion du logement (Patrick Bouchain), l’engagement vers les plus pauvres (Rural Studio). Cependant, ni la ville planifiée ni le logement comme standard hygiéniste et fonctionnaliste ne semblent pouvoir être remis en question suffisamment pour que les utilités et qualités (d’échelle, d’implantation, de convivialité) du bidonville deviennent perceptibles derrière les injonctions d’une « modernisation perpétuelle, compulsive, obsessionnelle » (Zygmunt Bauman). On sait pourtant que le standard de la cellule de logement hygiéniste-fonctionaliste, érigé en doxa par les politiques du logement des années 1960, ne convient pas à toutes les conditions d’existence ni à toutes les cultures et situations de vie. Ni par son prix, ni par son indisponibilité, ni même par ce qu’il est. Colette Pétonnet montrait déjà dans On est tous dans le brouillard que le bidonville abrite une sociabilité impossible à transporter dans l’univers des grands ensembles, non que le cadre spatial soit inadapté par sa forme, mais parce qu’il est trop rigide pour que s’y développent des usages sociaux libres, hors des cultures dominantes, a fortiori populaires. Partout dans le monde, la projection de ce modèle idéalisé en remplacement forcé du bidonville a montré ses limites. Le standard du logement contemporain ne convient qu’à des gens désireux de délaisser une collectivité plurifamiliale d’entraide et la possibilité d’une activité sur le lieu même de l’habitation. Aujourd’hui, cette inadéquation pèse sur certains quartiers d’habitat sociaux au point de remettre en cause les bases d’organisation que sont l’unité familiale et la séparation travail-logement. « Nous entrons dans un monde urbain où l’habitat est au coeur de toutes les inquiétudes mais où l’architecture du logement ne fait plus sens », écrit Paul Landauer, qui annonce dans Habiter. Imaginons l’évidence ! « la fin du logement » comme « pièce numéro un des théories urbaines et des utopies sociales des architectes ». Il faudrait donc « bidonvilliser » les grands ensembles ! Teddy Cruz, après des années de travail dans les bidonvilles de Tijuana au Mexique, propose que l’habitat en général soit redéfini comme un système d’interactions économiques et culturelles, et la densité comme une somme d’échanges par hectare.
CHANGER DE PARADIGME
Process plutôt que produit, l’habitat devrait d’abord répondre de son existence humble et utile pour tous. Osons déclarer la possibilité d’habiter à moindre coût comme un enjeu supérieur à celui d’habiter selon les normes. Le confort et les convenances n’ont aucune légitimité prioritaire : il n’y a pas de « logement indigne ». Depuis toujours, l’accès au logement de première nécessité est assuré principalement par ce qu’on appelait autrefois les « taudis » : entassements en sous-location, caves, rebuts du marché locatif. La question que posent ces logements est moins leur inconfort que leur exploitation par un sous-marché locatif malhonnête qui abuse des situations précaires par des prix élevés et des conditions véreuses. Les auto-installations individuelles et collectives échappent à cet écueil, c’est un point de plus à leur actif. Il n’y a pas de solution unique pour accueillir les parcours de vie fragilisés par la migration, les mutations économiques, les parcours personnels. Aussi bien le locatif très social, les structures d’hébergement, la mobilisation de logements ou de bureaux vacants par la puissance publique sont utiles. Le bidonville, parce qu’il bénéficie de forces d’autoconstruction rapides, parce qu’il peut être multicommunautaire, parce qu’il ramène le coût du logement à son niveau le plus bas, enfin parce qu’il existe et peut se déployer facilement, mérite d’entrer dans le cercle des habitats légitimes et vertueux. Avec les mêmes moyens, on peut aider l’ensemble des habitants d’un bidonville à améliorer leurs conditions de vie plutôt que d’offrir à long terme, à un seul, un logement « convenable ». Affirmons par conséquent notre estime du bidonville, faisons respecter ses droits, travaillons son acceptabilité publique, ouvrons-lui des implantations nouvelles. Intéressons-nous à le faire entrer dans le droit commun et à améliorer ses conditions d’installation pour que « demeurer » se puisse. Dans un premier temps, il s’agit peut-être seulement de reconnaître les habitants de bidonvilles comme « acteurs » de leur logement, assez pour leur confier officiellement l’usage à durée déterminée d’un terrain, cette durée fut-elle de quelques années. Il est possible d’actionner des formes de stabilité contractualisée – différents contrats existent – formalisant des engagements réciproques. Un statut d’occupation claire ouvrirait aux habitants les droits attachés à la domiciliation et les aiderait à s’extraire de la précarité. Les urbanistes peuvent favoriser ce « droit à la ville » en associant à la planification urbaine l’occupation temporaire encadrée des terrains « en attente » : friches, dents creuses, terrains gelés par la puissance publique pour des projets futurs de ZAC ou d’équipements publics : un capital foncier souvent inexploité pendant vingt ans. Le relais des acteurs de la ville mû par une sensibilisation politique permettrait le renouvellement régulier de ce réseau de terrains associant le respect du domicile et celui de la propriété. Une aide financière aux communes concernées serait dévolue à la réalisation d’équipements minimum (électrification, arrivée d’eau, sanitaires) qui coûteraient nettement moins cher à la collectivité que le prix exorbitant des expulsions-destructions. Si l’Europe ne veut pas ériger des murs ni refouler toujours plus loin la pauvreté et la vulnérabilité, il nous appartient de ne pas camper sur des impuissances acquises et d’ouvrir d’autres voies. Donner un sol et un statut au bidonville dans la cité est une clé immédiatement possible, associée à une aide architecturale de terrain à inventer, respectueuse des savoir-faire en présence. Il ne suffit pas de projeter nos révoltes morales pendant que le statu quo du rejet se maintient. Ici est proposée une avancée possible.
Les articles récents dans Point de vue / Expo / Hommage
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Comme les années précédentes, le Prix d’architectures 2023 organisé par notre revue a suscité… [...] |
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Il était temps qu’une exposition rende hommage à Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), l’un des … [...] |
 |
Face à la catastrophe climatique dont l’opinion publique a largement pris la mesure avec la ter… [...] |
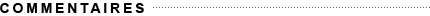
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |
|
Quelle importance accorder au programme ?
Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |
 |