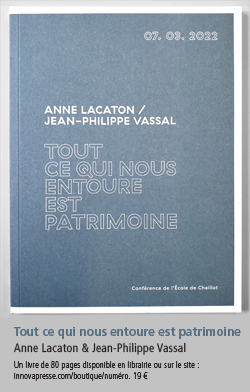Le musée du quai Branly : une architecture prise à son propre piège
Rédigé par Emmanuel CAILLEPublié le 02/07/2006
Devant la confusion qu’instaure l’émergence simultanée des « indigènes de la République », du triomphe de la world culture ou du redressement des peuples dits « premiers », il eût été illusoire de penser que ce musée puisse apporter LA réponse. Sa véritable réussite se jugera à l’aune de sa capacité à s’imposer comme outil de réflexion. Née dans la douleur de l’abandon du musée de l’Homme et de la gestion délicate de notre passé colonial, peu d’institutions auront été attendues avec autant d’animosité. Chaque décision, chaque mot sont devenus un piège potentiel, et l’on comprend que la forme architecturale donnée à cette ambition, loin d’être anodine, peut en modifier la portée. La cruauté avec laquelle la presse anglo-saxonne a ridiculisé le bâtiment de Jean Nouvel le démontre suffisamment (lire la revue de presse de Françoise Fromonot page 73).
L’architecte de l’Institut du monde arabe a cette fois voulu imaginer une architecture qui repose sur des vocabulaires non-occidentaux, inventer une modernité propre à ce programme et rompre avec les codes traditionnels des musées. C’est à la mesure de ces ambitions que l’on peut aujourd’hui analyser sa réalisation. Toutes les promesses sont loin d’avoir été tenues. à contrario, certaines des intentions émises lors du concours, et dont on pouvait craindre les développements, ont trouvé dans le musée, notamment dans la scénographie, une puissance d’expression d’autant plus regrettable qu’elles paraissent relever d’un contresens. Au palais de justice de Nantes, Jean Nouvel s’était saisi de la typologie conventionnelle de ce type de bâtiment. Réinterprétant ses éléments canoniques (parvis, colonnade…), exacerbant sa trame structurelle dans sa régularité et sa symétrie, il la démultipliait dans l’infini que lui offraient virtuellement la noire profondeur de ses ombres et les jeux de reflets qui s’y perdaient. Il pulvérisait ainsi la contrainte géométrique de la grille en un espace de liberté où pouvait se déployer une matière spatiale inédite, aussi fascinante que morbide. Au musée Branly, sa vaine tentative d’échapper aux codes de l’archi-tecture occidentale oblige Jean Nouvel à renoncer à une telle stratégie mais, dédaignant le type, il ne trouve que des clichés (le mythe des origines, la forêt mystérieuse et sacrée). Le travail de dématérialisation précipite alors cet imaginaire dans un monde d’images qui ne renvoient qu’à elles-mêmes. Le spectacle peut bien nous ravir, les objets exposés se réduisent à des éléments du décor.
S’intégrer ou disparaître ?
Sur ces berges de Seine où les riverains avaient réussi à faire échouer le projet de Centre de conférences internationales, Jean Nouvel a eu la prudence stratégique d’imaginer un bâtiment moins haut que le plafond autorisé et de se placer, de part et d’autre, en retrait de la rue. Vu depuis la rive droite, le musée n’émerge que partiellement de la canopée des arbres du quai. Les différents corps de bâtiment s’accrochent sagement, en les prolongeant, aux cinq murs pignons des immeubles du XIXe siècle qui forment un peigne depuis l’avenue de la Bourdonnais.
L’une des bonnes surprises du Quai Branly tient à cette volonté de rompre avec les grands projets mitterrandiens qui flattaient la mégalomanie du commanditaire : c’est en effet à une sorte d’exercice de camouflage auquel se sont livrés les Ateliers Jean Nouvel. Le jardin de Gilles Clément, encore à l’état embryonnaire et dont on pourra juger de la pertinence dans quelques années, renforcera encore cette impression. Depuis la Seine, tout est conçu pour décourager l’appréhension du bâtiment comme objet circonscrit dans des limites précises. La façade de la grande nef du musée, avec ses boîtes en porte-à-faux, semble vouloir nier la notion même de façade en refusant à la fois l’instauration d’un ordre lisible et l’idée d’une surface séparant un dedans d’un dehors. Un dispositif de plans successifs jouant de leurs similitudes feintes ou réelles et de leur capacité de réflexion, vient jeter le trouble sur la matérialité de ce que l’on perçoit : en arrière-plan, la partie vitrée décorée de motifs sylvestres sur laquelle s’accrochent les boîtes ; sur la droite, en avant, le bâtiment Branly recouvert de végétation ; viennent ensuite les arbres du jardin, ainsi que ceux existants, sur les quais. Entre les deux, démultipliant les reflets des uns sur les autres, s’interpose un grand mur vitré qui clôt le jardin, comme Jean Nouvel l’avait fait à la Fondation Cartier.
Les deux bâtiments construits à l’alignement de ceux existants, l’un côté quai, l’autre rue de l’Université, jouent aussi, chacun dans un registre différent, à difracter les limites perceptibles de leur façade. Dans leur simplicité et leur façon de ne se soumettre qu’à l’effet d’une seule idée, ils sont sans doute les plus réussis de l’opération. Avec sa luxuriante perruque de végétation due à Patrick Blanc, le bâtiment Branly côté Seine incarne, presque avec humour, l’idée de camouflage, mais en inversant l’intention dissimulatrice, puisque c’est de celle-ci qu’il tire son éclat et sa singularité. Le bâtiment Université, simple parallélépipède au gabarit parisien, joue quant à lui habilement des miroirs qui habillent, dans l’épaisseur du mur, l’encadrement en débord de ses grandes fenêtres. Ils donnent l’illusion que les plafonds peints par des artistes aborigènes se prolongent au-delà de la limite extérieure de la façade. Les motifs ainsi projetés se mêlent aux vieux immeubles de la rue et à la tour Eiffel dont les images se reflètent à leur tour dans les miroirs. Cet espace d’indécision, où intérieur et extérieur se confondent, suffit à animer la façade pourtant sage de ce bâtiment qui abrite la librairie et les ateliers de restauration.
Et la matière résiste
C’est donc faire un mauvais procès à Jean Nouvel que de lui reprocher, comme certains critiques anglo-saxons l’ont écrit, de n’avoir pas su faire de ce musée un bel objet plastiquement élégant, comme savent le faire Zaha Hadid ou Frank Gehry. Car c’est bien à cette forme de monumentalité contemporaine, à cette tentation d’autocélébration ethnoculturelle qu’il a voulu échapper. Dans son inlassable obstination à vouloir redéfinir la modernité, il considère que l’invention ne relève plus de la création de formes inédites. Pour autant, le projet n’hésite pas à sacrifier une partie de son budget à des volontés formelles arbitraires. Ainsi en est-il des pilotis soutenant la grande nef, qui « se prennent pour des arbres ou des totems » et permettent au jardin d’occuper presque tout le terrain. Disposés dans cette intention analogique sans souci des efforts à reprendre, ils créent des porte-à-faux obligeant à construire une titanesque structure métallique, finalement cachée sous des plaques de plâtre peintes. Autant les célèbres porte-à-faux des Palais des congrès de Tours ou de Lucerne, structurellement mieux conçus, se justifiaient par la tension qu’ils induisaient dans leur rapport au paysage et qui spécifiait leur statut, autant, à Branly, l’effort paraît disproportionné à l’effet. On peut s’interroger sur la capacité du bâtiment à proposer une alternative qui légitime ce renoncement aux codes architecturaux : suffit-il, pour concevoir une architecture non-occidentale, de prendre le contre-pied des canons de composition classiques ? D’empiler les couches sans grande rationalité constructive ? De dessiner des sols irréguliers ? De saturer le visible par l’hétérogénéité des matériaux et la profusion des effets de façade ? Lorsque Jean Nouvel déclare : « j’aime le film qui me fait oublier la caméra, comme j’aime l’architecture qui me fait oublier les moyens constructifs1 », on peut y voir une forme de sagesse, étant entendu que la beauté ne réside pas forcément dans la juste expression de l’architectonie. Mais qui veut faire disparaître la technique doit d’autant moins l’oublier et mieux la maîtriser en amont, au risque, comme ici, de la voir réapparaître sournoisement dans l’entrebâillement des panoplies de capotages. « Peu importe les moyens, écrivait Jean Nouvel avec prémonition, seul le résultat compte : la matière par moments semble disparaître, on a l’impression que le musée est un simple abri sans façade, dans un bois… Quand la dématérialisation rencontre l’expression des signes, elle devient sélective2. » Mais la matière résiste, et le dessein, ambitieux, s’est ici heurté aux dures contingences du monde de la technique et de la construction. Lévi-Strauss opposait, dans La Pensée sauvage, le bricoleur et l’ingénieur ; on espère que l’approximation constructive des bâtiments n’est pas ici un hommage mal compris au maître du structuralisme. Car si le bricoleur se définit entre autre par sa capacité à s’arranger avec les moyens du bord, contrairement à l’ingénieur dont la tâche est subordonnée à l’obtention de matières premières et d’outils définis précisément en fonction de son projet, les 170 millions d’euros (HT) qu’aura coûtés le musée n’autorisaient ni le bricolage, ni une qualité d’exécution qui rappelle davantage celle d’un collège 400 que celle d’une institution culturelle internationale majeure.
Train fantôme
Les exégètes du travail de Jean Nouvel voudront voir dans ce qui nous apparaît comme un décorum de pacotille, notre incapacité à décaler notre point de vue. Nous ne saurions pas voir que dans cette esthétique de l’immanence, les sensations qui naissent du jeu des reflets, des textures ou des lumières ouvrent un champ bien plus vaste que les canons d’une architecture qui ne serait essentiellement perçue qu’à travers la matérialité de l’espace. En donnant à une image projetée la même valeur que cet espace, c’est l’essence même de l’architecture qui, devenant un lieu de production d’images, en est bouleversée. Jean Nouvel revendique une « architecture parlante », il sature le visible de signes et nous immerge littéralement dans l’épaisseur de cette autre matière. Au risque d’altérer notre propre subjectivité, s’estompe alors la frontière délimitant le réel qui nous est donné de notre univers mental, uniquement composé, lui, d’images intérieures. Le visiteur devient alors l’acteur d’une fiction mise en scène par l’architecte, véritable maître des cérémonies dirigeant sa propre narration. Du jardin aux salles d’exposition, un vrai parcours initiatique est organisé : « tout est fait pour provoquer l’éclosion portée par l’objet premier, […] pour capter le rare rayon de soleil indispensable à la vibration, à l’installation des spiritualités. C’est un lieu marqué par les symboles de la forêt, du fleuve, et les obsessions de la mort et de l’oubli […]. C’est un endroit unique et étrange. Poétique et dérangeant3. »
On voit très vite quels pièges Jean Nouvel s’est ainsi tendu à lui-même : en virtuose des ambiances détonantes, il nous entraîne dans les représentations toutes personnelles qu’il s’est fait des mondes « premiers », au risque de nous prendre en otage de ce regard qui laisse perplexes bon nombre d’anthropologues (lire l’entretien avec Alban Bensa en page 70). Dans un parcours de train fantôme, la scénographie nous offre un voyage digne de Tintin et le temple du Soleil. Elle nous ramène à tous les clichés de l’exotisme que la création de cette institution s’est donné pour noble tâche de combattre : après la traversée du « jardin-forêt, sombre et mystérieux » (sic), on emprunte une interminable rampe baignée dans une sonorisation de tam-tams et de bruits de la savane, on pénètre ensuite dans un tunnel noir avant de déboucher dans les salles d’exposition proprement dites. Là, dans une atmosphère de sous-bois tropical ou du temple maudit d’Indiana Jones, on se glisse entre des parois aux formes molles garnies de peaux de bête. La géographie du sol, sans doute pour évoquer un milieu naturel, fuit l’horizontalité. À travers sa treille de métal recouverte de bois, la grande façade aux vitrages tapissés de photographies de forêts projette ses ombres sylvestres. Dans cette pénombre, on contourne d’énormes poteaux habillés d’une coque aux motifs « ethnos » dans le style des boutiques Nature & découvertes, et masques, totems, pirogues et parures viennent à nous, subtilement éclairés par Georges Berne. Le contour des vitrines s’efface judicieusement pour ne laisser apparaître que les objets. Par transparence ou reflets sur le verre, d’autres pièces sont visibles, démultipliant leurs images à l’infini comme dans une galerie des miroirs. Seul le changement de couleur du linoléum nous indique que nous passons d’un continent à l’autre, l’ambiance de forêt tropicale survivant au bush abori-gène et au blizzard inuit. Si cette mise en scène rend grâce à la beauté que notre regard prête à cette somptueuse collection, peu d’informations nous aident à nous dégager de l’ethnocentrisme inhérent à notre point de vue. Si la scénographie nous emporte, dans son maelström d’images, dans un indéniable émerveillement, on se demande ce qui la différencie de celle d’un parc à thème sur Le Livre de la jungle : « Ici l’illusion berce l’œuvre d’art. […]. Le jardin parisien devient un bois sacré et le musée se dissout dans ses profondeurs4. » À bien le relire, Jean Nouvel ne nous a pas menti, c’est moins en architecte qu’en illusionniste nostalgique de Kipling qu’il semble avoir conçu ce musée. On comprend mieux aujourd’hui sa célèbre phrase : « L’architecture est la pétrification d’un moment de culture. »
Emmanuel Caille
1. Jean Nouvel, « Projects, Competitions, Build-ings », Architectures in Transition, Prestel, 1991, p. 104.
2. Lettre d’intention de Jean Nouvel pour le concours de 1999.
3. Ibidem.
4. Ibidem.
Lisez la suite de cet article dans :
N° 157 - Septembre 2006
Les articles récents dans Point de vue / Expo / Hommage
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Comme les années précédentes, le Prix d’architectures 2023 organisé par notre revue a suscité… [...] |
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Il était temps qu’une exposition rende hommage à Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), l’un des … [...] |
 |
Face à la catastrophe climatique dont l’opinion publique a largement pris la mesure avec la ter… [...] |
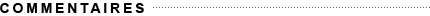
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |
|
Quelle importance accorder au programme ?
Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |
 |