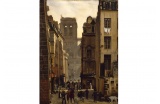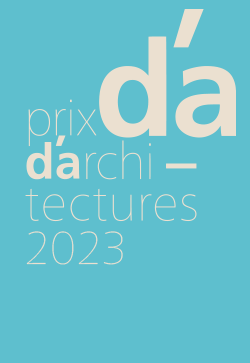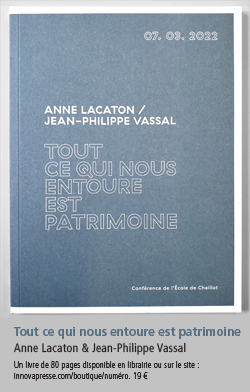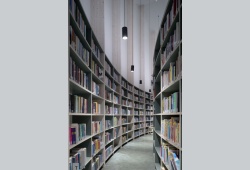Notre-Dame, le parvis des petits besoins
Rédigé par Jean-François CABESTANPublié le 06/07/2021

|
Au lendemain du sinistre du 15 avril 2019, on se rappelle que l’annonce d’un concours international avait suscité des propositions de toutes sortes quant à la reconstruction des parties hautes du monument sinistré. Ce torrent d’images déconcertantes émanant pour certaines d’agences de renom n’a pas peu contribué à faire le lit des restaurateurs stricto sensu, et à discréditer toute intervention d’ordre architectural. |
Quelques années auparavant, pourtant, la Mission Île de la Cité confiée par François Hollande à Dominique Perrault et Philippe Bélaval avait abouti à des hypothèses d’une reconquête de l’île. Si ce projet présenté en février 2017 paraissait abandonné, l’incendie lui redonnait tout d’un coup un caractère d’actualité. Pendant qu’on s’orientait peu à peu vers une restitution de la cathédrale dans son dernier état connu, entérinée par l’Élysée le 9 juillet 2020, certains observateurs étrangers stigmatisaient le manque d’ambition de la requalification de ses abords.
Le moment n’était-il pas venu de reconsidérer le sort du parvis piétonnier pratiqué par André Hermant et Jean-Pierre Joue au-dessus de la crypte archéologique et des deux étages de parking souterrains mitoyens de cette dernière, livrés en 1974 ? Pour le Politecnico de Turin et le Centre for Heritage de l’université de Newcastle-upon-Tyne, l’incendie de Notre-Dame représente un défi à relever : la réintégration de l’édifice à restaurer dans le contexte élargi de l’île et plus généralement du Grand Paris. Sur la base d’un diagnostic préalable solide, chercheurs, professeurs, étudiants italiens et britanniques ont lancé des hypothèses de projet fécondes voire décapantes d’un possible devenir d’une île qui ne s’est jamais remise de sa reconfiguration brutale initiée sous le règne de Napoléon III. Par un réseau de complicités que les confinements successifs ont raffermi, deux journées d’étude ont été programmées à Paris pour donner de la publicité à ces avancées de la réflexion hors de nos frontières. Elles se sont finalement tenues les 7 et 8 juin derniers à l’Institut national d’histoire de l’art ; leur contenu – dont l’article ci-après donnera un aperçu de la teneur – sera très prochainement mis en ligne2.
Par une coïncidence fortuite, elles sont tombées au moment même où la Ville de Paris lance une consultation sur le réaménagement des abords de la cathédrale. Loin des ambitions d’un Perrault, le périmètre envisagé se limite au parvis et aux jardins situés au sud et à l’est du monument sinistré, dans une logique qui se procède de la réinvention des places parisiennes : République, Bastille et bientôt Denfert-Rochereau. Quatre équipes pluridisciplinaires seront sélectionnées sur dossier d’ici à la fin de l’été. Elles produiront des esquisses, qui selon le régime d’un dialogue compétitif, donneront lieu à un voire deux tours de table. L’équipe lauréate sera désignée à l’été 2022. Il est prévu que les travaux démarrent à l’issue des jeux Olympiques de 2024. La participation souhaitée du public vient de donner lieu à l’ouverture d’un site dédié où chacun est appelé à donner son avis. La ville prévoit un budget de 50 millions d’euros, environ 6 % de ce qui doit être dépensé pour le monument lui-même. L’envergure et les modalités de la consultation font douter que la Ville ait pris la pleine mesure des enjeux très bien perçus à l’étranger. C’est du destin de l’un des monuments les plus fréquentés, voire des plus populaires d’Europe qu’il s’agit, dont l’inscription urbaine relève pour Paris de l’un des très grands projets du siècle.
Architecte en chef de la cathédrale de 2000 à 2013, Benjamin Mouton a activement pris part à ces journées d’étude de l’INHA. Sa communication s’est imposée comme une sorte de synthèse conclusive qui, à la surprise de certains, a repris et faite siennes plusieurs des hypothèses exprimées tour à tour au fil des sessions. Le grand praticien et spécialiste incontesté en matière de patrimoine expert auprès de l’Unesco nous livre ci-après l’état des réflexions qu’il mène sur les abords des cathédrales depuis une quinzaine d’années, convaincu que, selon le mot d’Yvan Christ, une cathédrale gothique n’a jamais été conçue pour décorer une place publique.
1. La formule revient à Jean-Michel Leniaud, ancien directeur de l’École des Chartes.
2. Voir le site www.jeanfrancoiscabestan.com
Les articles récents dans Point de vue / Expo / Hommage
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Comme les années précédentes, le Prix d’architectures 2023 organisé par notre revue a suscité… [...] |
 |
Une chronique de la série "Malentendus sur l'architecture et abus de langage de ses disciples" par … [...] |
 |
Il était temps qu’une exposition rende hommage à Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), l’un des … [...] |
 |
Face à la catastrophe climatique dont l’opinion publique a largement pris la mesure avec la ter… [...] |
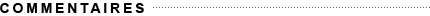
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |
|
Quelle importance accorder au programme ?
Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |
 |