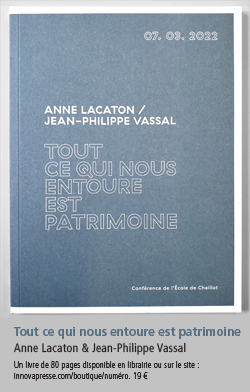Robert Doisneau, le noir et blanc en couleur
Rédigé par Jean-Paul ROBERTPublié le 13/12/2017
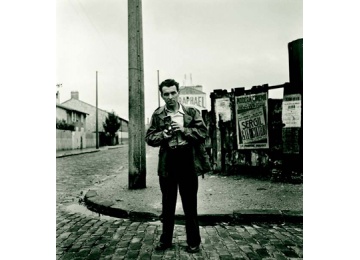 Autoportrait, Villejuif, 1949 |
La notoriété de Robert Doisneau (1912-1994) n’est plus à établir. Elle repose sur les photographies en noir et blanc d’un siècle qu’il a traversé l’œil ouvert et bienveillant, ainsi que le rappelle la réédition de l’ouvrage de Brigitte Ollier chez Hazan. Invité sur le tard à participer à la mission de la Datar – dont le rôle fondateur est rappelé à la BNF avec l’exposition « Paysages français » –, il revisite la banlieue, en couleur, objet d’un livre, éclairé d’un texte de Claude Eveno et publié par Dominique Carré. |
Paris doit tant à Doisneau ! La capitale est
bien sûr fondée par l’histoire et par la pierre, mais elle ne serait pas sans
les lettres et les images. Celles de Doisneau expriment le génome de la ville.
Si elles se sont imprimées dans les esprits, c’est qu’il en a rendu, après
Atget, et avec quelques autres de sa génération, la beauté singulière et
ordinaire, la grandeur et la familiarité, l’ordre et les surprises, et surtout
la vie des Parisiens et des Parisiennes, leurs moments quotidiens ou
exceptionnels. La ville était alors habitée par tous, et tous se côtoyaient
sans discrimination ni exclusion. Paris était un peuple.
Doisneau a l’œil rieur et aimable. C’est ainsi qu’il portraiture un jour de 1955 son pote Jacques Prévert, dans la rue, face à la devanture d’un magasin Merode (vêtements pour hommes). Le poète, plutôt que figé dans une pose, est à l’arrêt, regard de labrador, bajoue hitchcockienne et clope vissée au bec, main dans la poche. Doisneau s’est baissé : la silhouette un peu lourde de Prévert, en contre-plongée, se monumentalise. Sa tête masque et remplace le O de la marque inscrite sur l’auvent de la boutique. De sorte qu’il ne reste que cinq lettres pour former le mot de Cambronne, qui court comme un phylactère issu du personnage. C’est drôle, c’est gai, c’est canaille : toute la gouaille des Parigots est dans l’image, pleine de spontanéité : la scène est saisie, sur le vif, sans apprêt, comme en passant.
L’image fond aussi le personnage et le décor, ils sont indissociables, ne peuvent exister l’un sans l’autre. Noirs, blancs, gris, dans le même grain, la même matière photographique, transcrivent avec la profondeur de champ le miracle de l’existence de l’être au monde dans un monde dessiné et formé pour l’être. Pareil miracle est capté par un homme qui sait se mettre au bon endroit, à l’instant juste, avec la complicité de la lumière exacte. Toutes les images parisiennes de Doisneau ont cette même empreinte, cette même facture, sont pleines, entières, parcourues de la même félicité grave, quand même les sujets ou les moments n’invitent pas au bonheur d’un baiser échangé sur la place de l’Hôtel-de-Ville, icône à laquelle a été réduit le photographe.
Ni nostalgie, ni mélancolie
Doisneau était un homme du peuple. Un banlieusard, aussi. Avant et après la guerre, la banlieue n’était pas riante. Elle était plutôt noire, charbonneuse, effilochée, maussade. Le poète Blaise Cendrars en dira la violence dans le texte du premier ouvrage de photographies de Robert Doisneau, La Banlieue de Paris, publié en 1949. Mais ses images ne sont pas à l’unisson de la rage de l’écrivain. Elles restent pleines d’empathie pour les vies qui se déroulent là, malgré tout. « Je donnais, dira-t-il, la priorité aux personnages. Le fond n’était que décor un peu hostile et absurde. Les individus n’en paraissaient que plus tendres et plus fragiles. On leur souhaitait un décor plus beau. » Et d’ajouter : « Les individus que je mettais devant, c’était des autoportraits. » Magnifique aveu, qui donne la place exacte d’un photographe, aussi peu narcissique soit-il : celle de l’homme qui est là, présent dans ce qu’il voit et qu’il saisit et qu’il donne à voir, en acteur, en témoin, en passeur, en passant.
Robert Doisneau, célébré, honoré, récompensé, racontait que longtemps son métier n’avait pas été considéré. Il avait été un prolétaire de l’art, et avait trouvé dans les paysages prolétaires de la banlieue l’occasion de portraits de cette condition, plus qu’un autoportrait. Malgré la violence, la dureté, la cruauté de lieux sans joie, la vie, modeste, trouvait place, éclatait parfois sur fond de fumées et de ciel gris : un jeu de gosses dans un terrain vague, une farandole dans la gadoue, un cortège de mariages sur le pavé, un bal chez Temporel, une manif, un cyclo-cross, ou plus simplement un repas dans le jardin, une sortie avec bébé, un moment de solitude, un bain au soleil…
Aucune mièvrerie dans cet album d’une époque que les Glorieuses allaient bousculer, avant de l’éradiquer. Déjà dans les années 1970, Doisneau avait surpris l’intrusion dans les paysages de la périphérie d’objets brutaux et démesurés. Il en avait saisi les contrastes : ceci menaçait cela. Mais toujours la vie était là, gardait le dessus, résistait. Cette résistance apparaissait comme une critique portée à l’espérance d’un avenir meilleur. Ni nostalgie, ni mélancolie, comme on l’a attribué si souvent et si faussement à Doisneau, mais chanson, qui rappelle que la réalité a toujours raison, critique d’un temps qui prétend la plier à son orgueil et des forces qui écrasent ou piétinent les humbles.
La lutte sauvage
Lorsque François Hers et Bernard Latarjet, maîtres d’œuvre de la mission photographique de la Délégation à l’aménagement du territoire, s’adressent au début des années 1980 à Doisneau, celui-ci, soupçonne-t-on, leur sert de couverture, d’alibi, de caution. Tous les photographes retenus ont autour de la quarantaine, comme eux ; Doisneau, le septuagénaire, fait figure de vétéran ; ses images sont connues et reconnues ; il illustre à lui seul le genre du photoreportage, voire du pittoresque ; il incarne la photo « humaniste », renvoie à l’avant. Eux pensent à revitaliser la photographie de paysage à une époque où le paysage de la France a été bouleversé par trois décennies de croissance qu’il s’agit de réévaluer en en constatant les effets.
Et pour cela, « la Mission exige de la photographie une intensité retrouvée du regard sur la réalité : intensité d’autant plus difficile qu’elle ne doit rien à l’événement », écrivent-ils dans l’ouvrage publié en 1985 rendant compte des premières campagnes. Dans cette « nécessité de dégager des voies qui répondent aux besoins de renouvellement de la photographie elle-même », « un travail comme celui de Robert Doisneau est exemplaire ». C’est que, avec « l’audace d’un artiste qui décide à 70 ans de relever de nouveaux défis dans le domaine de sa propre pratique photographique », il a « dégagé des solutions nouvelles pour lui – choix de la couleur, élimination des scènes avec personnages ».
Et Doisneau, qu’en dit-il ? « Ces maisons que je détestais, maintenant je les préfère aux grands parallélépipèdes verticaux qui les poussent. C’est la lutte sauvage. » « Avec l’arrivée de la couleur, l’échelle a changé, l’économie familiale cède devant une société qui produit des bâtiments plus volumineux, peints, maquillés. Il fallait absolument faire de la couleur. C’était nécessaire, une documentation supplémentaire. » La couleur, ainsi, n’est pas un choix esthétique arbitraire ; elle s’impose au photographe parce qu’elle s’est imposée dans la réalité pour travestir la production qu’elle maquille. « L’élimination des personnages » n’est pas davantage le fait de Doisneau : dans les paysages de banlieue, il n’y a plus personne, il n’y a que des voitures.
Une anticomposition
Il lui faut aussi changer de point de vue. Il ne peut plus se contenter d’être un passant au niveau du sol. Il lui faut prendre de la distance devant ces nouveaux objets qui repoussent, prendre de la hauteur devant eux qui toisent. Le point de vue qu’adopte Doisneau le plus souvent n’est plus à hauteur des acteurs d’une scène, parce qu’il n’y a plus ni personnage, ni scénographie : ni peuple, ni ville. L’œil est détaché, insituable, à la fois plus lucide, plus critique et plus éloigné. Ce changement est celui d’une condition nouvelle, dépossédée d’existence.
Cet état de la banlieue qu’a documenté Doisneau voici déjà plus de trente ans nous est à la fois familier et étrange. Familier, parce qu’il est, pour l’essentiel, toujours là. Étrange, parce qu’il apparaît pour ce qu’il n’est plus depuis longtemps : neuf, propre, pimpant – encore que sur un mode dérisoire, tels les jeux d’enfants au pied des immeubles, quand il n’y a pas âme qui vive, quand il ne peut y avoir de vie dans un paysage sans âme projeté par des esprits sans tête, à moins que ce ne fussent des têtes sans esprit.
Dans ces pérégrinations de 1984, Doisneau a retrouvé Prévert, son ancien compagnon de bitume, sur le pignon d’un bloc de logements à Villeparisis. Une effigie géante, dérisoire, posée là pour faire oublier la misère d’un lieu sans poésie. Encore une fois, Doisneau choisit son point de vue : au premier plan, une entrée de garage, engageante comme la porte de l’enfer, au-dessus de laquelle apparaît au loin la tête démesurée et sans corps de l’ami disparu, cigarette, toujours, aux lèvres. Une anticomposition, qui dit mieux qu’autrement la tristesse de cette descente aux limbes.
Ces strates de temps, que Doisneau a connues et fixées, l’écrivain Claude Eveno les parcourt dans le livre très soigné qu’il a conçu avec Dominique Carré et Bernard Latarjet. Il en a été le témoin, lui qui est né au sortir de la guerre et en a suivi les transformations et les effets. Il est retourné sur certaines des scènes photographiées par Doisneau. Eveno se sert de l’appareil de l’écriture pour dresser un portrait de l’état d’aujourd’hui, forcément empreint du souvenir de ce qu’il fut. Il écrit qu’« un jour, sans doute, ces images feront pleurer d’une intense émotion ». C’est vrai. Mais elles délivrent aussi un message moins nostalgique, plus optimiste. Parce qu’elles rappellent que ce qui est n’a pas toujours été, elles démontrent qu’un autre monde reste possible.
Brigitte Ollier, Robert Doisneau, éditions Robert Hazan, Paris, 2017, réédition de l’ouvrage de 1996, 26 x 20 cm, 672 pages, 39 euros.
Robert Doisneau, la banlieue en couleur, texte de Claude Eveno, Dominique Carré éditeur pour les éditions La Découverte, Paris, 2017, 17 x 24 cm, 112 pages, 21 euros.
L’exposition de la Bibliothèque nationale de France, « Paysages français », qui présente en particulier les originaux de Doisneau pour la mission de la Datar de 1984, est ouverte sur le site François-Mitterrand jusqu’au 4 février 2018. www.bnf.fr
Lisez la suite de cet article dans :
N° 259 - Décembre 2017
Les articles récents dans Photographes
 |
En 2001, le peintre anglais David Hockney publiait un ouvrage consacré à l’usage des appareils … [...] |
 |
Le CAUE 92 de Nanterre accueille jusqu’au 16 mars 2024 une exposition intitulée «&nbs… [...] |
 |
L’école d’architecture de Nanterre, conçue en 1970 par Jacques Kalisz et Roger Salem, abandonn… [...] |
 |
Aglaia Konrad, née en 1960 à Salzbourg, est une photographe qui se consacre entièrement à l’ar… [...] |
 |
Maxime Delvaux est un jeune photographe belge, adoubé par des architectes tels que Christian Kerez,… [...] |
 |
Harry Gruyaert expose tout l’été au BAL, haut lieu parisien de la photographie, créé en 2010 p… [...] |
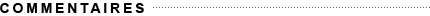
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |
|
Quelle importance accorder au programme ?
Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |
 |