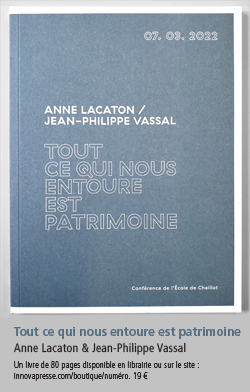Entretien avec Alain Roger : « Faute de modèles, nous ne savons pas “voir” esthétiquement »
Rédigé par Cyrille VÉRANPublié le 23/11/2017
 Le Repos pendant la fuite en Égypte, suiveur de Joachim Patinir. XVIe siècle. Collection MRBAB Bruxelles. |
Dossier réalisé par Cyrille VÉRAN Auteur d’un essai sur le paysage il y a vingt ans, jugé radical pour certains, le philosophe Alain Roger déplore la frilosité conservatrice de notre perception paysagère qui n’a guère évolué depuis la parution de son ouvrage en 1997, et notre incapacité à dépasser les seules valeurs écologiques ou objectives d’un territoire. |
d’a : Dans votre ouvrage Court traité du paysage, vous expliquez que c’est par la médiation du regard que naît la perception du paysage. Pouvez-vous revenir sur cette idée ?
Alain Roger : Le paysage est le fruit de ce que je nomme, en reprenant au mot du philosophe Charles Lalo (1912), qui l’empruntait lui-même à Montaigne, une « artialisation ». Celle-ci peut s’exercer de deux façons : soit directement, sur le socle naturel du pays (artialisation in situ), et c’est l’art ancestral des jardins et, tout récemment, du Land Art ; mais elle peut aussi, et surtout, s’appliquer indirectement, par la médiation du « regard » (artialisation in visu), qui lui imprime ses modèles culturels, picturaux, littéraires, etc. Tel est le paradoxe qu’Oscar Wilde propose dans Le Déclin du mensonge (1890), réalisant ce que je n’hésite pas à nommer la révolution copernicienne de l’esthétique : « La vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie […]. À qui donc, sinon aux impressionnistes, devons-nous ces admirables brouillards fauves qui se glissent dans nos rues, estompent les becs de gaz, et transforment les maisons en ombres monstrueuses ? À qui, sinon à eux encore et à leur maître [Turner] devons-nous les exquises brumes d’argent qui rêvent sur notre rivière et muent en fidèles silhouettes de grâce évanescente ponts incurvés et barques tanguantes ? Le changement prodigieux survenu au cours des dix dernières années, dans le climat de Londres, est entièrement dû à cette école d’art. » On peut le vérifier historiquement : il n’y a pas de paysage en Europe occidentale (il en va différemment de la Chine ancienne) avant le Quattrocento. Le pays n’est devenu un paysage que par l’invention picturale de celui-ci chez les peintres flamands (Campin, Van Eyck, etc.), qui s’est traduite presque aussitôt par la création du vocable (landscap, lanscape, landschaft, paysage, paesaggio, etc.)
d’a : Vous soulignez qu’au cours de l’histoire, des entités géographiques considérées comme hostiles dans l’imaginaire – la mer, la montagne, le désert, le marais… – ont accédé au statut de paysage par les représentations culturelles qui en ont été faites, et que la crise du paysage traduit surtout la sclérose de notre regard. Nous ne savons pas voir nos complexes industriels ou la puissance d’une autoroute. En 2017, vingt ans après la parution de votre ouvrage, ces propos vous semblent-ils toujours d’actualité ? Ne savons-nous pas voir nos paysages périurbains ?
La montagne et la mer sont des acquisitions paysagères relativement récentes dans notre sensibilité. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, la montagne, par exemple, n’est qu’un « affreux pays ». Elle ne deviendra « sublime » que par la médiation des écrivains (Haller, Gessner, Rousseau, Saussure), puis, au XIXe siècle, des photographes (Bisson, Soulier, Civiale). Faute de tels modèles, nous ne savons pas « voir » esthétiquement. Rien n’a fondamentalement changé depuis vingt ans. J’en veux pour preuve notre perception des éoliennes, qui s’est dévaluée. Alors qu’on les considérait, à l’origine, plutôt positivement, comme éléments d’un possible paysage, elles sont désormais, le plus souvent, dénoncées comme sa détérioration. Je les citais volontiers comme des éléments valorisants, au large d’une côte ou au long d’une autoroute, mais, désormais, la pression écologique, naguère indulgente, sinon tout à fait favorable, est devenue franchement hostile et je me garderai de porter un jugement définitif. Quant à nos « paysages périurbains », je doute fort qu’une amélioration paysagère se soit produite en ce qui les concerne. J’ai, pendant trente ans, habité en région parisienne et je n’ai pas l’impression que la sensibilité paysagère y ait beaucoup évolué. On oscille toujours d’une dénonciation à l’autre : celle de la cité-dortoir et celle de l’univers pavillonnaire.
d’a : Paysage, nature, environnement. On emploie souvent ces termes indifféremment, qui ont pourtant un sens précis, même dans les colloques de spécialistes, avec le risque de réduire le paysage à une dimension écologique. Quelles en sont les conséquences pour l’aménagement du territoire ?
La conséquence principale est un conservatisme frileux, qui consiste à s’en tenir aux seules valeurs écologiques, mesurables, au détriment des valeurs paysagères, qui ne le sont pas (elles peuvent seulement être appréciées, ce qui ne veut pas dire évaluées). L’aménagement du territoire n’obéit, le plus souvent, qu’à des considérations objectives, nuisances phoniques à éviter, suppression, à l’entrée des villes, des panneaux publicitaires, etc. Cela n’est pas négligeable, mais cela ne suffit pas à assurer la promotion paysagère, qui répond à d’autres critères, proprement esthétiques. Je me rappelle les difficultés que j’ai rencontrées, quand j’enseignais à l’École d’architecture de Paris-La Villette, dans le DEA Jardins, paysages, territoires (1992-2002), pour articuler les trois termes, « jardins » et « paysages » dépendant de la double artialisation, in situ et in visu, tandis que « territoires » renvoyait à l’environnement, via la notion d’aménagement. On ne peut « aménager » un paysage, on peut tout au plus, dans cette perspective, le préserver, un concept purement conservateur, à l’opposé des valeurs paysagères, qui sont en évolution incessante.
d’a : On ramène également souvent le paysage à la notion d’écologie, d’ailleurs on a créé l’écologie du paysage. Là encore, vous désapprouvez totalement ce terme. Quelles en sont les dérives ?
Si la notion de paysage est d’origine artistique, le concept d’environnement est, quant à lui, d’inspiration scientifique. On le voit bien avec Ernst Haeckel et sa définition de l’écologie : « Par Oekologie nous entendons la totalité de la science des relations de l’organisme avec l’environnement, comprenant, au sens large, toutes les conditions d’existence » (1866). Mais c’est surtout avec le botaniste britannique Arthur George Tansley et sa théorie des écosystèmes que l’environnement se pose en concept scientifique, synthétique et conquérant, prêt à tout absorber, le paysage compris. Je me garderai de toute polémique quant à la prétention de l’écologie à s’ériger en science de l’environnement. Je conviens volontiers qu’une telle prétention est justifiée, que l’écologie, bien menée, peut être une science à part entière, et c’est précisément pour cette raison que je lui dénie le droit de s’ériger en science du paysage, sous le nom de landscape ecology. Et je camperai sur mes positions aussi longtemps qu’on ne m’aura pas démontré qu’une science du beau est possible, que ce dernier est quantifiable, et qu’il existe une unité de mesure esthétique, analogue au décibel des nuisances phoniques. Cela ne veut pas dire qu’une étude géographique ou écologique du lieu – ce que j’ai appelé « pays », par opposition au « paysage » – est superflue. La connaissance des géosystèmes et des écosystèmes est évidemment indispensable, mais elle ne nous fait pas avancer d’un pas dans la détermination des valeurs paysagères, qui sont socioculturelles. L’analyse objective d’un biotope, la mesure du degré de pollution d’une rivière n’ont littéralement rien à voir avec le paysage. La réduction écologique du paysage à son environnement est toujours néfaste, si tentante soit-elle. C’est pourquoi j’irai jusqu’à dire qu’il faut protéger le paysage contre ses protecteurs, en soustraire la gestion, comme la création, à tous ceux qui s’arc-boutent à une conception conservatrice, voire réactionnaire, de l’aménagement du territoire. Combien d’écologistes n’ont qu’une vision bucolique et archaïque du paysage français ? Combien d’associations de « défense » brandissent naïvement, comme paysage « naturel » à préserver, un modèle culturel, hérité du XIXe siècle et souvent obsolète, l’Île-de-France de Corot, celle des impressionnistes, etc ?
d’a : Vous trouvez très contestable cette notion de protection des paysages défendue par l’action publique. Pourtant, la valeur patrimoniale du bassin minier des Hauts-de-France, par exemple, aujourd’hui reconnue, et la politique de protection mise en place permettent de lui donner un nouveau départ, avec des projets de paysage qui le valorisent et réenclenchent une dynamique économique, sociale, culturelle. Cette notion de protection n’engage-t-elle donc pas, parfois, des actions positives ? Et si ce n’est pas le cas, quelle serait la bonne attitude à observer selon vous ?
J’en conviens volontiers, l’exemple que vous citez est tout à fait probant. Je ne conteste pas que le bassin minier, même figé dans son passé, détienne aujourd’hui une valeur paysagère patrimoniale, commémorative d’un passé révolu, mais qui peut revêtir, à nos yeux, une certaine valeur esthétique, plus ou moins nostalgique (le terril, même reverdi). On peut, dès lors, l’aménager et le préserver. J’éprouve néanmoins quelque inquiétude devant une telle opération qui, si elle se généralisait, tendrait à sanctuariser tout ou partie du territoire. J’en veux pour exemple cette Charte architecturale et paysagère, édictée par le Conseil régional de l’Auvergne en 1992 et tout à fait édifiante. Après avoir rappelé les caractères de l’architecture de l’Auvergne, la charte, animée d’un beau zèle pédagogique, nous enseigne, photographies à l’appui, les « options regrettables » et « les aspects positifs » ; autrement dit : ce qu’il faut faire ou ne pas faire, au nom, bien entendu, de la sacro-sainte intégration, qui compte parmi les « notions élémentaires et familières ». Mais le conservatisme ne se limite pas au bâti, il s’étend aux plantations, pour lesquelles on devra « préférer les feuillages caducs aux feuillages persistants, planter des essences locales et non exotiques, sans les mélanger : tilleuls, marronniers, platanes, noisetiers, érables, frênes, éviter les prunus rouges, saules pleureurs, pins d’Autriche, thuyas et autres essences étrangères ». On croit rêver…
d’a : Une demande qui est souvent faite aux paysagistes consiste dans l’art de la dissimulation ou de l’intégration. Tout ce qui semble inconvenant à nos yeux, autoroutes, voies ferrées, sites industriels, doit être caché, ce qui vous semble un leurre. Pourquoi ? Et quelles seraient donc la ou les manières de s’emparer de ces paysages perçus comme des balafres ?
Oui, mais c’est ce complexe de la balafre que je voudrais dénoncer, car il postule un paysage en soi, qu’il faudrait à tout prix préserver et, par conséquent, le caractère criminel de l’autoroute, puisque telle est, aujourd’hui, la cible de toutes les passions : une blessure que l’on doit, tant bien que mal, essayer de réduire ou, du moins, de dissimuler. Comme le soulignait naguère l’architecte paysagiste Pierre-Marie Tricaud, « puisque le concepteur d’une route considère que son projet ne peut avoir qu’un effet négatif sur le paysage comme sur l’environnement, il appelle le paysagiste pour le camoufler ». Triste vocation de celui qui pouvait se croire investi d’une mission créatrice, et qui se voit réduit au camouflage, oui, quel camouflet ! Il convient, me semble-t-il, d’abandonner cette vision honteuse de l’autoroute. Non seulement celle-ci constitue, en elle-même, un authentique paysage, mais, comme le TGV d’ailleurs, elle en produit de nouveaux. Il ne s’agit donc pas de cacher l’estafilade, ni d’en cicatriser les abords à coups de pansements végétaux, une conception décorative et curative, d’un mot : décurative, qui résume assez bien la mission qu’on assigne au paysagiste. Prenons le problème à l’envers : si l’on pousse jusqu’au bout, c’est-à-dire à l’absurde, ce complexe de la balafre et sa logique du camouflage, on aboutit à la nécessité d’enterrer les autoroutes, non seulement dans les agglomérations et autres zones sensibles (ce qui se justifie) mais sur l’ensemble du territoire. Toute la métropole minée par ce nouveau métro… Plus de blessures, mais plus de paysages alentour, sinon pour ceux qui, de loin en loin, remonteraient par quelque « bouche » de cette métraupinière hexagonale. À nous, au contraire, de savoir transformer cette balafre en visage et cette plaie en paysage.
d’a : Les paysagistes estiment qu’on ne prend pas assez la mesure de leur rôle, qui reste à élargir et à conforter. Partagez-vous ce constat ?
Certes, je suis pleinement d’accord avec eux. Mais, je l’ai trop souvent constaté, les paysagistes se résignent trop souvent et finissent par adopter une conception trop frileuse de leur rôle. Il est vrai que l’on cherche à les limiter par tous les moyens, à commencer par les ressources budgétaires, comme ce 1 %, naguère alloué au paysagiste pour la réalisation des autoroutes et qui le condamnait, au mieux (ou au pire…) à dissimuler l’impact, quel qu’il fût, sur le paysage « à préserver ». C’est cette conception de l’intégration, ancrée dans la conscience collective comme allant de soi, qui sévit à tous les niveaux, du permis de construire individuel aux réalisations collectives. Il conviendrait, au contraire, de se libérer d’un tel dogme et, sans donner pour autant dans le n’importe quoi, de faire davantage confiance au paysagiste, en élargissant son rôle. Je voudrais, à cet égard, dénoncer un préjugé, l’obsession du vert, entretenue par les écologistes et de nombreux défenseurs de l’environnement. Pourquoi cette verdolâtrie ? Parce que le vert renvoie au végétal, donc à la chlorophylle, donc à la vie ? Sans doute, mais est-ce une raison pour ériger cette valeur biologique en valeur paysagère ? (On pourrait citer nombre de peintres et d’ingénieurs qui jugent, au contraire, que le vert n’est pas une « bonne couleur ».) Faut-il qu’un paysage soit une vaste laitue, une soupe à l’oseille, un bouillon de nature ? Voilà, de nouveau, le degré zéro du paysage, et l’on n’a pas progressé d’un pas dans la création paysagère, quand on s’est contenté d’installer des « espaces verts », même si, du point de vue de l’environnement, l’amélioration est mesurable.
d’a : Votre essai est paru il y a maintenant vingt ans ; quel cheminement votre réflexion a-t-elle parcouru depuis ?
Je n’ai guère évolué dans ma réflexion paysagère depuis vingt ans. J’ai mis un peu d’eau dans mon vin culturaliste, à la suite des critiques, parfois virulentes, que m’ont valu mes réflexions un peu trop polémiques, sur l’écologisme et la verdolâtrie. On a trop souvent (et à tort) vu en moi un apôtre de l’économisme. J’ai également dû, bien souvent, au hasard des colloques, batailler ferme au sujet de ma thèse centrale sur la double artialisation, jugée trop radicale, et sur la distinction entre paysage et environnement. Mais, sur l’essentiel, je reste intransigeant. Mon culturalisme demeure intact : il n’y a pas de paysage naturel, c’est une contradiction dans les termes. Tout paysage est un produit culturel. Ce qui fausse notre perception, c’est que, dans un pays comme le nôtre, tout, ou presque, est culturel. Il faut pratiquer une véritable ascèse pour se dépouiller de sa culture et tenter de renouer avec cet X qu’est devenue la nature. Notre œil est surchargé de modèles qui viennent continuellement l’obstruer, au point qu’une vision naïve nous est pratiquement impossible et que, paradoxalement, nous avons la nostalgie d’une telle vision, qui nous paraît, à tort, paradisiaque. C’est parfois ce que je ressens désormais : cette nostalgie d’un état pré-culturel qui, à rebours de ma thèse, m’apparaît comme un autre modèle, d’ailleurs tout aussi culturel, mais inaccessible : la pure nature.
Agrégé de philosophie et docteur d’État, Alain Roger a été professeur d’esthétique à l’université de Clermont-Ferrand et chargé de cours dans le DEA Jardins, paysages, territoires, à l’École d’architecture de Paris-La Villette. Auteur d’une douzaine de livres, essais et romans, il a consacré plusieurs ouvrages à la question du paysage. Son Court traité du paysage, paru en 1997 aux éditions Gallimard, a récemment été réédité dans la collection Folio Essais.
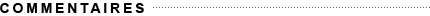
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
« En décidant de ne pas tout transformer, tout change » - Entretien avec Alexandre Chemetoff
Réutiliser, transformer, restructurer, revaloriser… autant d’actions souvent recommandées quand les enjeux de l’époque incitent à retravai… |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |