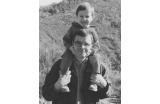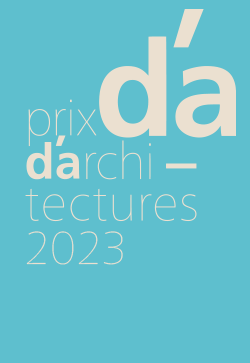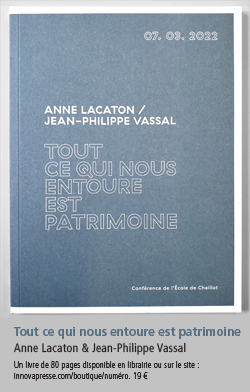Stéphane Couturier, photographe archéologue du temps présent
Rédigé par Yasmine YOUSSIPublié le 14/06/2004
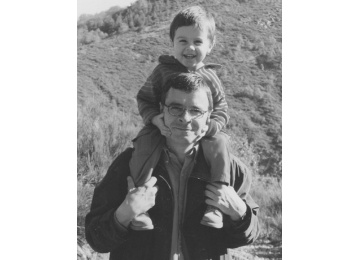 Stéphane Couturier |
Il
a été l'un des plus grands photographes d'architecture des
années 1980, avant de bifurquer, au début de la décennie suivante,
vers une photographie d'auteur. Stéphane Couturier, prix Niepce
2003, expose aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. L'occasion
d'évoquer ensemble son parcours.
|
d'A : Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner la photo d'architecture ?
Stéphane Couturier : À l'exception de Jean Nouvel, qui cherche dans le regard des photographes quelque chose qui lui permette d'en apprendre plus sur son propre travail, la plupart des architectes traitent les photographes comme des prestataires de service destinés à magnifier leur bâtiment au moment où il se termine, avant appropriation des lieux. Le photographe, finalement, leur importe peu puisque ces images sont toujours faites au même moment, sous une belle lumière, à partir du meilleur angle, en évitant les plantes vertes. Ces photos se sont standardisées au fil du temps. À tel point qu'il est désormais difficile de faire des choses intéressantes. En 1994, j'ai commencé à montrer mon travail personnel en galerie. Ce travail prenait le contre-pied de ce que j'avais réalisé jusqu'alors, même si j'y appliquais le même vocabulaire. Il s'attachait à des lieux contextuels, en mutation, mettant en avant le côté organique et vivant de la ville. La bonne réception de ces photos m'a inscité à abandonner ma collaboration avec les architectes. Ça a été pour moi une manière de m'affranchir de leur censure. Certains refusaient, par exemple, de passer des photos que je jugeais intéressantes. J'avais pourtant essayé de changer les choses à travers Archipress. L'idée de cette agence était de trouver des regards photographiques sur l'architecture et l'urbanisme avec des gens comme Gabriele Basilico ou Jacqueline Salmon. Malheureusement, on s'est retrouvé devant un mur d'incompréhension, les architectes considérant les revues spécialisées comme une plaquette de pub.
d'A : Qu'est-ce qui caractérise votre vocabulaire photographique ?
S.C. : Je dirais qu'il tourne autour de la frontalité et du fragment. Je remplis totalement le cadre de mes photos. L'œil ne s'y fixe pas sur un point, il circule au sein de l'image qui l'enferme. Et c'est l'expérience vécue par le spectateur qui l'accroche. Plus que le sujet, c'est sa composition qui m'intéresse. J'aime montrer quelque chose de mouvant, constamment en évolution. J'utilise aussi le grand format parce qu'il engendre la proximité, permet de détailler les éléments, de révéler les indices et donc de dévoiler le réel mieux que le réel ne permet de le voir. Une manière de dire qu'il s'agit encore d'un document. Je suis là pour constater et non pas pour dénoncer. C'est pour cela que je tiens à rester neutre, tout en préservant l'ambiguïté de ce qui est montré
d'A : Comment vous définissez-vous aujourd'hui ?
S.C. : Difficile à dire. Ça m'embête de me cantonner au seul documentaire. Certes, mes images sont le document photographique de quelque chose qui a existé à un moment donné. Elles portent aussi en elles une réflexion sur l'image que l'on souhaite donner du monde actuel. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'arriver à synthétiser document et art. Je trouve important d'avoir une image conceptuellement forte qui soit au carrefour de la photo, des arts plastiques, de l'architecture, de l'urbanisme, de la sociologie, de la politique, et que le spectateur puisse s'approprier la photo telle qu'il en a envie.
d'A : Comment travaillez-vous ?
S.C. : Mon idée n'est pas de montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir mais plutôt de révéler la ville telle qu'elle est, sans tricher. La série des Monuments a commencé à Séoul. Tout le monde m'avait dit que c'était l'une des villes les plus laides du monde, ce qui avait immédiatement suscité ma curiosité. Je me suis immergé dans cette mégalopole en la sillonnant pendant quinze jours en voiture. Au début, je voulais montrer le côté « archéologie urbaine » de toutes ces constructions qui se font et se défont dans le centre. Sauf qu'en périphérie, j'ai buté sur d'énormes tours de 25 à 30 étages, destinées aux classes supérieures et qui sont l'emblème du capitalisme triomphant. J'ai alors compris que mon sujet était là. Parce que Séoul, c'est avant tout cette organisation à la périphérie, avec une densification unique au monde. Aucune de ces tours n'est identique. On est pourtant dans l'uniformité parce que la variation est infime. Nous jugeons peut-être cette architecture abominable. Il n'empêche que les Coréens en sont très fiers. Pour eux, c'est un modèle pour dépasser la petite maison individuelle sans hygiène ni eau courante.
d'A : Quelle vision avez-vous de l'architecture aujourd'hui ?
S.C. :
Mon opinion est
étrangère aux photos que je fais. Encore une fois, je souhaite
avant tout poser des questions. Ce qui ne m'empêche pas d'être
effrayé par la muséification de centres-villes du midi de la
France, par exemple. Ces lieux sont habités par des notables et le
plus gros de la population réside en périphérie. Les centres sont
touristiques, mais, à 19 heures, il n'y a plus personne. La vraie
ville se retrouve en périphérie. Comme si les architectes n'avaient
pas réfléchi à la mixité des espaces. Les zones sont soit
résidentielles, soit commerciales, soit industrielles, mais on n'a
pas encore trouvé de lieu qui vive vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Je suis aussi frappé par la privatisation des espaces
publics. Après les États-Unis, la France y arrive. Une manière de
rester entre soi, de se « protéger » de gens jugés
indésirables. C'est comme ça que les ghettos se créent. Depuis
le 11 septembre, ça s'est amplifié. Il devient d'ailleurs très
difficile de faire des prises de vue dans ces conditions.
À lire : Stéphane Couturier, éditions Adam Biro, 144 pages, 45 euros.
Les articles récents dans Photographes
 |
Délicate et profonde, l’œuvre de Sandrine Marc couvre tout le processus photographique, de l�… [...] |
 |
En 2001, le peintre anglais David Hockney publiait un ouvrage consacré à l’usage des appareils … [...] |
 |
Le CAUE 92 de Nanterre accueille jusqu’au 16 mars 2024 une exposition intitulée «&nbs… [...] |
 |
L’école d’architecture de Nanterre, conçue en 1970 par Jacques Kalisz et Roger Salem, abandonn… [...] |
 |
Aglaia Konrad, née en 1960 à Salzbourg, est une photographe qui se consacre entièrement à l’ar… [...] |
 |
Maxime Delvaux est un jeune photographe belge, adoubé par des architectes tels que Christian Kerez,… [...] |
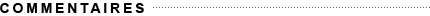
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
« En décidant de ne pas tout transformer, tout change » - Entretien avec Alexandre Chemetoff
Réutiliser, transformer, restructurer, revaloriser… autant d’actions souvent recommandées quand les enjeux de l’époque incitent à retravai… |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |