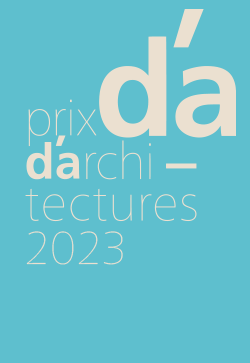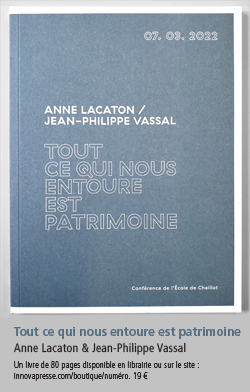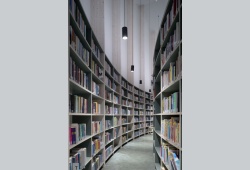Agence Richter et Associés : l'architecture est une conversation
Rédigé par Karine DANAPublié le 02/05/2018
 Anne-Laure Better entourée de Jan et Pascale Richter |
Au commencement de l’histoire de l’agence Richter Architectes et Associés : une carte de France imaginaire où le Rhin est un centre et non plus une frontière, le cœur d’un territoire entre Vosges et Forêt-Noire… |
Il faut dire que Pascale et Jan Richter, de père est-allemand et de mère française, ont grandi en Allemagne où ils ont aimé pratiquer ces rudes bâtiments de béton brut aux plans simples, efficaces, et aux menuiseries si précises. Une expérience déterminante de la construction et des atmosphères. Passées leurs jeunes années, ils franchissent le Rhin, étudient l’architecture à Strasbourg et fondent leur agence en 1999. « C’est comme si on continuait une forme d’enfance… », s’amuse Pascale Richter. Une troisième associée les rejoint en 2007, Anne-Laure Better. Cette Alsacienne qui partage ce même goût du « bien faire » est une ancienne étudiante de Pascale à l’ENSA de Strasbourg. Tous trois sont certes diplômés de cette même école mais ils ont construit leurs références au gré d’allers-retours et de voyages dans d’autres villes. À Paris, en suivant parallèlement à leurs études la pédagogie du groupe UNO diffusée par Henri Ciriani à l’ENSA de Belleville pour le frère et la sœur. Pascale suit ensuite l’enseignement de Carlos Reverdito à Montevideo, en Uruguay, et Anne-Laure part à Los Angeles.
Dans cette dynamique d’évolution et d’élargissement motivée par une forte conscience de la nécessité de déplacement du regard, ils développent leur intérêt pour les questions sociales. C’est aussi à Strasbourg que, pendant leurs études, Pascale et Jan Richter travaillent pour le paysagiste Alfred Peter, et dans une pépinière spécialisée en plantes vivaces en Allemagne. Très tôt, ils s’interrogent sur les manières si différentes d’aborder la nature en France et outre-Rhin. « En Allemagne, on considère la nature pour ce qu’elle est, on assume ses variations, ses débordements. En France, en revanche, on a du mal à laisser faire, à laisser pousser, on cherche à dessiner la nature et on met sans doute les choses trop à distance », expliquent les architectes. Fondamentale pour comprendre leur approche du vivant, cette vision attentive aux conditions de l’appropriation et de la liberté constitue une culture commune aux trois associés. Elle nourrit constamment leur réflexion sur l’architecture, leur approche des relations spatiales et des continuités, et leur façon toujours très directe de poser les bâtiments sur un territoire : comme des structures ouvertes sur la ville, comme des arrière-plans, des bruits de fond.
Dans leur projet d’écoquartier Danube en cours d’achèvement, à Strasbourg, ils sont parvenus à orienter la cour d’une école sur un grand jardin public afin qu’en dehors des plages scolaires la cour fonctionne dans le prolongement de l’espace urbain. Cette volonté de toujours associer les espaces deux à deux, de « travailler les lieux devant les lieux », d’intégrer des respirations dans les circulations, de faire fonctionner des espaces intérieurs avec des vides plantés ou de construire des prolongements pour le regard est une attitude récurrente de leur méthodologie de projet. Chacun témoigne de la même énergie pour que l’œil habite l’espace, que la perception soit toujours en éveil et que s’invente continuellement un plan derrière un plan, une séquence après une autre. Cette exigence tient à leur grande expérience des EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Pascale Richter a appris que, « pour une personne âgée, il est fondamental de savoir où elle est, de comprendre ce qui va lui arriver sans pour autant tout discerner, ni avoir complètement quitté le monde qui est derrière elle ».
Structures d’urbanité
Cette pratique et cette compréhension des bâtiments médicaux-sociaux, des constructions souvent très épaisses, conduisent les architectes à travailler les profondeurs, les diagonales, à étirer les plans et à inventer des dispositifs de mobilité inédits. Il s’agit toujours de démultiplier le sentiment d’espace, de lieu, pour des personnes amenées à demeurer là. Cette attention est particulièrement sensible dans le premier bâtiment significatif que l’agence a livré, en 2010 : la maison d’accueil spécialisée de Lure (Haute-Saône), un édifice dédié aux personnes cérébro-lésées, qui ne sont connectées au monde que par les yeux. Face à cette situation limite et si intime, l’équipe s’est demandé comment l’architecture pouvait devenir partie prenante du protocole de soins. Chaque déplacement du regard a ainsi été conçu pour être vécu comme une promenade mentale, chaque sous-face comme un paysage ou un ciel.
Aborder ainsi l’architecture – de manière si fondamentale, voire métaphysique – comme une façon d’accompagner l’individu à trouver sa place dans le monde conduit les architectes à implanter des formes fortes1, comme a pu les évoquer le critique Martin Steinmann, convaincu qu’il existe une expérience immédiate des choses à travers l’architecture. Chez Richter Architectes et Associés, ces figures de stabilité renvoient à des organisations classiques – plans carrés, symétriques, plans en U, plans à patio – abordées de manière toujours indissociées des questions de l’usage, des pratiques, du mouvement. L’apport et la situation de ces « formes fortes » dans la ville sont d’autant plus importants qu’elles s’inscrivent le plus souvent dans des contextes urbains décousus et confus, comme en périphérie de Strasbourg. Ainsi les projets de l’agence agissent-ils comme des structures d’urbanité, des nouveaux points de départ dans des quartiers qui peuvent ainsi être réactivés par l’architecture.
Cette attitude est très lisible à Lingolsheim, où les architectes ont juxtaposé une série de programmes dédiés au sport, à l’enfance, aux personnes âgées, dans un bâtiment unique situé en fond de ZAC. Par son ouverture tout à fait inattendue dans un contexte de petits collectifs isolés sans interfaces avec la ville, ce complexe linéaire fabrique une nouvelle centralité, et les conditions d’une nouvelle rue, d’autres pratiques urbaines. « D’une certaine manière, notre architecture cherche toujours à entrer en conversation avec ce qui l’entoure et à mettre ensemble. »
Stammtisch
Cette double approche – entre cadre fixe, ordonnateur, et accueil de la vie – repose sur une attention égale portée à la valeur constructive et à celle des usagers – intégrés au processus même de projet. Les trois associés partagent ce goût commun pour la qualité bâtie. Un objectif qui est selon eux moins difficile à atteindre à Strasbourg, où les missions d’exécution sont confiées aux architectes. Ainsi et pour chaque projet, ils réalisent des prototypes de façades qui leur permettent de questionner tous les détails et de valider tous les matériaux avec les entreprises. S’il est abordé avec une certaine obsession, le détail ne revêt cependant jamais de fin démonstrative. Au contraire, il existe pour intégrer les assemblages et les dispositifs techniques, faire tourner les angles, faire oublier la complexité : pour servir la lecture des espaces.
Suivant une même volonté de mettre les idées à l’épreuve du réel, de les tester et de les confronter, l’agence associe très en amont les utilisateurs à la conception des espaces en les canalisant autour d’un nuancier référence : une photo, un tableau, un montage qui concentre les ambiances et textures du projet. Cette culture de l’écoute que l’équipe a développée à force de travail sur des programmes médicosociaux tient aussi de sa vision de la place de l’architecte, nécessairement élargie hors de l’agence et au-delà des bâtiments : dans la vie publique. En ce sens, le rôle d’enseignants engagés qu’ils tiennent tous trois à l’ENSAS et l’INSA pour Anne-Laure et Yan, et à l’ENSA de Paris Belleville pour Pascale constitue un champ d’exploration essentiel.
Il est un autre mode d’action que les architectes se plaisent à déclencher à partir de réflexions citoyennes et à la manière des Stammtische – un terme allemand qui désigne une tablée autour de laquelle se réunissent des gens pour discuter. Cette habileté à capter et à fédérer a d’ailleurs donné naissance au groupe de travail « Wasistdas »,où Pascale Richter et six autres acteurs non architectes se regroupent toutes les semaines depuis huit ans autour de problématiques urbaines, notamment strasbourgeoises. Et c’est avec cette même liberté d’organisation et de parole que Pascale a cofondé à Strasbourg les Journées de l’architecture en 2000. Cet événement – aujourd’hui institutionnalisé tant il a pris de l’ampleur – a été déterminant pour la construction d’une vision transfrontalière du territoire. Ne perdant jamais le fil de cette précieuse situation d’ouverture, l’agence cultive avec détermination les possibilités d’échanges avec l’Allemagne, où elle vient de remporter son premier concours : un projet urbain à l’entrée de la ville de Baden-Baden, où Pascale Richter a été longtemps architecte-conseil. Moment tout à fait décisif pour le développement du bureau, ce concours gagné corrobore le montage de leur seconde agence à Paris, où l’équipe cherche aujourd’hui à inventer de nouvelles formes de regroupements avec d’autres confrères.
Groupe scolaire Simone-Veil, gymnase Colette-Besson, ZAC des Tanneries, Lingolsheim (67)
À la périphérie de Strasbourg, dans un contexte de production urbaine très hétéroclite, le projet prend place en fond de ZAC sur une parcelle très étirée et bordée par une voie ferrée. « Le principal défi a consisté à résoudre ce paradoxe entre cette situation en frange et la volonté affirmée du maître d’ouvrage d’y créer le cœur du quartier », expliquent les architectes qui ont pris le parti d’offrir un vide le long de la grande façade pour créer une connexion avec l’espace public de la ZAC. Ils font ainsi de cette situation de décentrement une invitation à la profondeur : cadrer les vues sur le passage des trains en arrière-plan et fabriquer un front bâti monolithique mais poreux. Ce front est révélé par la matérialité unitaire du bâtiment composé de prémurs de béton. Le projet s’inscrit dans une opération plus grande, comprenant également un institut médico-éducatif (accueillant des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle) et une résidence pour séniors, réalisés par les architectes Aubry Lieutier, associés à la conception du plan d’ensemble. L’IME est situé entre le groupe scolaire et le gymnase.
Profitant de cette linéarité, l’agence développe un travail sur le séquençage et la définition des vides. Trois typologies d’espace sont ainsi proposées : le vide majeur du square en vis-à-vis qui, par effet d’aspiration, rapproche le bâtiment du mail central du quartier ; le vide effilé de la promenade qui le prolonge et distribue les entrées des équipements ; et enfin les vides des cours et des patios plantés venant chercher la promenade. Ceux-ci créent des porosités vers les voies de chemins de fer qui de manière inattendue fabriquent un nouvel environnement, un arrière-plan à la fois ouvert et contenu dans les cadrages du bâtiment. Ainsi, le groupe scolaire est organisé en U autour d’une cour et le préau se prolonge sous le bâtiment pour rejoindre la promenade urbaine. En relation entre elles et en rapport avec la cour, la végétation et le ciel, les salles de maternelle sont installées au rez-de-chaussée. Ouvert sur le square et la rue, le gymnase a été abordé comme un lieu d’intensité urbaine, offrant aux promeneurs le spectacle des activités sportives et aux usagers un équipement caractérisé par ses différentes couches de transparence depuis la rue jusqu’au chemin de fer.
Maître d’ouvrage : Ville de Lingolsheim
Maître d’œuvre : Richter architectes et associés, mandataire ; Aubry Lieutier, architectes associés phase concours
BAT structure : SIB études
Paysagiste : Bruno Kubler
Missions : base + exe + signalétique
Surface utile : groupe scolaire 3 080 m2, gymnase 2 050 m2
Coût : groupe scolaire, 6,49 millions d’euros HT ; gymnase, 4,32 millions d’euros HT
Calendrier : concours, avril 2014 ; livraison, 2017
Projet urbain, Baden-Baden, Allemagne
Ce premier concours remporté en Allemagne par l’agence sur le site de Aumattstraße à l’entrée de Baden-Baden engage une réflexion urbaine et paysagère élargie sur le développement de cette ville thermale au cœur de la Forêt-Noire. La ville souhaite aujourd’hui d’une part se diversifier et développer notamment des services à haut niveau technologique, et d’autre part aménager une coulée verte traversant Baden-Baden d’ouest en est contenant le parc du centre historique. « Le site retenu offre une rare opportunité : incontournable car accolé à l’axe principal de Baden-Baden, il est à l’articulation entre la pré-ville à l’ouest et le centre-ville à l’est, et entre une structure urbaine ordonnée au nord et une structure quasi villageoise et organique au sud. Nous cherchons à travailler dans l’épaisseur, à prolonger ce tissu pavillonnaire tout en y intégrant des programmes tertiaires et à dégager le paysage autour de la rivière pour faire respirer la ville. » Ainsi, l’opération est scindée en quatre parties : une partie principale au sud, dévolue aux activités de services, devrait être réalisée à court terme ; une partie centrale, le long du ruisseau Oos, interdite de construction ; et deux parties au nord du ruisseau, pour une future transformation urbaine et programmatique. L’épannelage des bâtiments, alternant volumes hauts et bas, permet de développer des points de vue contrastés entre rue et nature, et de valoriser l’ampleur du paysage arboré.
Maître d’ouvrage projet urbain : Ville de Baden-Baden
Maître d’ouvrage bâtiments : Martin Dietrich
Architectes : Richter Architectes et Associés
Paysagistes : agence Ter Karlsruhe
Ingénieur transports : Raimund Wiotte
Programme mixte à dominante bureaux, parc urbain
Superficie SDP : 13 000 m2
Coût : 23 millions d’euros HT (bâtiments)
Calendrier : lauréat, janvier 2018 ; livraison 2021
Centre de soins pour enfants et adultes, ZAC Hauts de Queuleu, Metz (57)
« Offrir une plus grande ouverture tout en préservant l’intimité, faire écho au paysage ou à la ville tout en soignant l’individu, assurer la pérennité de l’ouvrage et lui permettre de s’adapter à de nouvelles fonctions et usages, chaque projet architectural tente de résoudre d’apparentes oppositions. » La conception d’une structure destinée aux soins psychiatriques donne à ces enjeux une importance singulière. Pour la conception de ce centre de soin à Metz Queuleu, l’agence a développé un bâtiment unitaire en béton, organisé autour de patios et ancré dans la pente du terrain. Cet équipement est caractérisé par un travail d’enveloppe très singulier réalisé. L’artiste Grégoire Hespel a travaillé à même le matériau béton en le désactivant très localement. À l’échelle du lieu, son intervention produit des variations de surfaces jouant avec cette situation mêlant échappées visuelles directes vers le paysage boisé et séparation strictes entre les services des enfants et des adultes. Tout en se protégeant de la vue directe du voisinage pour garantir la confidentialité du soin, les espaces intérieurs s’ouvrent en effet généreusement sur l’extérieur par le biais de façades vitrées et évolutives. Les aménagements intérieurs – cloisonnement, plafonds, mobilier –, quant à eux réalisés en panneaux de bois, permettront la modularité du plan en fonction des changements d’usages.
Maître d’ouvrage : centre hospitalier de Jury
Maître d’œuvre : Richter architectes et associés, mandataire
BET structure : CTE Mulhouse
Artiste : Grégoire Hespel
Missions : base + exe + signalétique + mobilier
SDP : 2 200 m2
Coût : 5,4 millions d’euros
Livraison : 2018
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, « Les Collines de la Seine », Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76)
À la limite d’une ZAC et d’une zone industrielle et à proximité d’un hôpital, le projet prend place sur un terrain pentu offrant de belles vues lointaines sur le grand paysage en contraste avec les vues proches qui donnent sur un ensemble urbain hétérogène. En partie haute au sud, le site s’ouvre sur les champs.
L’EHPAD épouse la topographie et profite de la pente pour superposer les fonctions du programme, et leur offrir des prolongations extérieures contrastées et adaptées aux besoins des résidents, du personnel et des visiteurs. Le rez-de-chaussée prolonge le parvis relié à la ville et au centre hospitalier voisin. Le rez-de-jardin, quant à lui, entre de plain-pied avec le verger au sud, dédié à la promenade, au jardinage, au jeu, à la contemplation. À l’étage, les unités de vie disposent de grandes terrasses. Animé d’une fresque de l’artiste Nathalie Siegfried, le hall se développe sur trois niveaux, accueille un grand escalier qui relie le parvis au jardin et se retourne vers le grand paysage. Les parcours intérieurs sont conçus comme des promenades, éclairées naturellement et rythmées par des vues contrastées.
Maître d’ouvrage : centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers/Val-de-Reuil
Maître d’œuvre : Richter Architectes et Associés, mandataire ; LEM+ architecte, associé suivi de chantier
BET structure : CTE Mulhouse
Missions : base + exe partiel
Coût : 9,4 millions d’euros HT
Livraison : 2017
EHPAD « Résidence de l’Alumnat » et aménagements extérieurs, Scherwiller (67)
« Dans son Éloge de la vieillesse, c’est non sans une certaine jubilation qu’Hermann Hesse décrit le passage de la vie active à une vie plus contemplative. Nous avons conçu la résidence de l’Alumnat en nous appuyant sur l’idée qu’en effet, cette disposition à la méditation, à l’égarement de l’esprit, au repos, à la convivialité feutrée, est aussi porteuse de bonheur. La mairie de Scherwiller, avec le soutien de la gériatre Elisabeth Kruczek, a partagé cette conviction. » C’est donc au plus près du cœur du village qu’a été implantée la résidence. Organisé en U, le projet permet un découpage des volumes à l’échelle du tissu voisin tout en proposant une façade d’entrée institutionnelle sur le parvis partagé avec l’église et l’école. Le plan intègre un espace paysager autour duquel s’organise la vie de la maison de retraite : jardin protecteur et rassurant où les volumes des chambres forment des façades de maisonnettes ; jardin animé par la terrasse de la salle à manger, le potager, les arbres fruitiers, la serre, la fenêtre de la chapelle ; jardin ouvert, offrant une vue cadrée sur le paysage lointain et sur la chapelle Saint-Wolfgang. À l’intérieur, les espaces sont organisés comme une structure « villageoise » : depuis une place centrale (le hall), les circulations sont imaginées comme des promenades offrant de multiples cadrages sur le paysage et la vie alentour, et de nombreux espaces propices à la contemplation, au repos, à l’échange.
Maître d’ouvrage : commune de Scherwiller
Assistance à maîtrise d’ouvrage : CAUE / Domial
Fauteuils et bridges : Fred Rieffel, designer
Missions : base + exe + signalétique + mobilier
Surface : 3 600 m2, 46 lits
Coût : 5,6 millions d’euros HT
Livraison : 2011
Prix : lauréat 2012 au Palmarès grand public archicontemporaine, catégorie santé et social ; mention 2016 au Palmarès de l’architecture et de l’aménagement en Alsace, catégorie logements
Restructuration et extension du Siège du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle,Schiltigheim (67)
L’objectif était « d’absorber » un bâtiment existant des années 1970 en augmentant sensiblement sa surface afin de réaliser un outil de travail confortable, fonctionnel et évolutif, dont les performances devaient être certifiées. Pour cette restructuration du siège du SDEA située au nord de Strasbourg, les architectes se sont appuyés sur le plan carré d’origine qu’ils ont étendu par homothétie pour loger le nouveau programme comprenant principalement le réaménagement du site, un centre administratif, un laboratoire d’analyse des eaux (qui constitue une aile à part) et des locaux pour les techniciens. Implanté au cœur d’une zone artisanale et commerciale en pleine évolution et sans ordre apparent, ponctuée de bâtiments aux échelles et façades hétéroclites, l’équipe a cherché à souligner le caractère institutionnel et pérenne de l’établissement, et à traduire par la construction et le traitement de ses abords l’attachement du SDEA à l’environnement et à la précision scientifique.
La réorganisation de la parcelle, quoique plus dense, a permis de développer tout autour du terrain – avec le botaniste Philippe Obliger – un écrin végétal composé de haies mixtes, de vergers et de prairies fleuries, propices au développement de la biodiversité, et de libérer totalement le périmètre du bâtiment tertiaire pour y créer un parvis et des jardins. Trois patios ainsi qu’un bassin planté d’hélophytes complètent ce dispositif paysager qui redéfinit en profondeur les transitions depuis l’espace public, l’ancrage au sol du siège et l’environnement immédiat des bureaux.
Les espaces intérieurs sont, quant à eux, organisés depuis l’entrée à l’angle sud-est. Le hall s’étire jusqu’au cœur du bâtiment, entre deux patios, comme un volume en triple hauteur dont l’escalier mène à la salle des commissions permanentes.
Le plan carré apporte au SDEA toutes les liaisons fonctionnelles nécessaires aux nombreux services et permettra de les faire évoluer. Le cloisonnement est modulaire, la trame alternant petites et grandes travées pour offrir une plus grande variété de surfaces. En façade, le calepinage précis des feuilles de zinc de couleur sombre et changeante interagit avec la végétation qui l’entoure.
Maîtrise d’ouvrage : SDEA Alsace-Moselle – Strasbourg
Structure charpente métallique : BWG
Botaniste : Philippe Obliger
Missions : base + exe + signalétique + mobilier
Shon : 8 344 m2
Coût : 12,25 millions d’euros HT
Calendrier : livraison de la première phase (extension) : janvier 2015 ; livraison de la seconde phase (réhabilitation) : juin 2016
1. Forme Forte : Écrits/Schriften 1972-2002, de Martin Steinmann, Princeton Architectural Press, 2003.
Les articles récents dans Parcours
 |
Depuis 2022, comme dans le film de Tim Burton Mars attacks !, l’agence Mars fondée par Julien B… [...] |
 |
L’histoire de l’agence arba démarre en 2002. Sihem Lamine – tout juste sortie de … [...] |
 |
Depuis 2007, Thibaut Barrault et Cyril Pressacco bâtissent ensemble leur vision de l’architectur… [...] |
 |
Après une phase consacrée au travail en agence, à l’enseignement, ainsi qu’à la maturation d… [...] |
 |
Depuis la double implantation de l’atelier PNG, à Paris et au pied des Alpes, Nicolas Debicki, Gr… [...] |
 |
Installée à Lyon, l’agence Vurpas Architectes s’entoure de compétences multiples pour mener �… [...] |
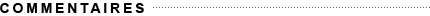
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |
|
Quelle importance accorder au programme ?
Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |
 |