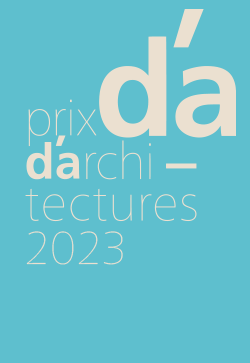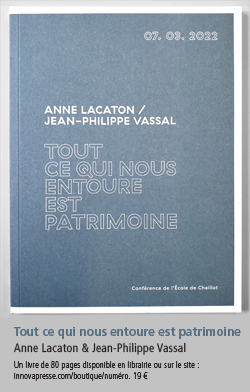Patrick Miara, ombres ligériennes
Rédigé par Olivier NAMIASPublié le 02/11/2015

|
Œuvrant aux frontières des codes de l’image d’architecture, Miara parcourt la crête étroite qui sépare la fidélité de la représentation de la nécessité de l’expression. |
« J’ai un besoin presque vital de m’exprimer par la photographie », confie Patrick Miara. Fils d’un photographe professionnel réalisant des travaux de studio et des reportages industriels du côté des Sables-d’Olonne, il accède tôt à des appareils photos, tout en forgeant sa culture de l’image à travers les arts plastiques et le cinéma. Le territoire local lui offre ses premiers sujets, des usines désaffectées en attente de démolition de la région nantaise. L’exploration visuelle des sites se cristallise dans des vues générales, pour se resserrer peu à peu sur un nombre réduit d’éléments. « J’ai gardé la même démarche dans mes photos d’architecture : de la vision élargie du projet, je me concentre progressivement sur des détails », explique Miara, qui préfère être qualifié de photographe tout court plutôt que de photographe d’architecture, l’attitude et la démarche primant sur l’objet photographié, ou les conditions d’une commande. Il faut bien constater que, depuis quelques années, Patrick Miara est présent dans l’architecture, documentant les travaux de plusieurs agences en vue en pays ligérien et au-delà : forma6, Garo Boixel, Leibar Seigneurin, DDL, Sabh, parmi d’autres. Pourtant, il ne savait pas que l’on pouvait se spécialiser dans l’architecture ! Intégré un temps à l’agence de presse SIPA, il fait ses premiers reportages d’architecture à La Roche-sur-Yon, pour l’agence DMT. « J’étais complètement ignorant des attentes des architectes. J’avais une forme d’innocence que j’ai l’impression d’avoir perdue depuis », dit Miara. Doté de plus d’expérience, il aborde toujours ses projets en novice : « Contrairement à certains de mes confrères, je ne fais pas de visite ou je ne prends pas rendez-vous avec l’architecte avant un reportage. Les agences me font confiance. » En tête à tête avec le lieu, le photographe renoue avec la lenteur, l’observation, dans une solitude qu’il semble apprécier.
Détourner les conventions
« J’ai longtemps photographié en noir et blanc, je tirais moi-même mes négatifs, passant des heures dans la chambre noire pour faire un travail qui pourrait s’apparenter à une manière de sculpter la lumière », se rappelle Miara. Comment retrouver cette expressivité de l’image, et de la personnalité de l’auteur, à travers le genre codifié de l’image d’architecture ? « Les vues générales sont les plus faciles à réaliser. Certaines apparaissent comme des évidences, et il n’est pas sûr que ma photographie d’un de ces points de vue serait différente de celle d’un autre photographe, poursuit-il. C’est dans les vues intérieures, plus serrées, où le cadre est encore plus important, que j’exprime des visions plus personnelles, tout en restant respectueux du travail de l’architecte. » Quel élément déclenche la prise de vues ? « La lumière, répond sans hésiter Patrick Miara, je ne photographie jamais par temps gris, car j’ai besoin des ombres. » Dans certaines vues intérieures de la tour des Arts, aux Herbiers, les structures de béton arborescentes dessinées par forma6 deviennent, dans une lumière contrastée laissant la part belle à l’ombre, les troncs véritables d’un mystérieux sous-bois.
Alors que l’on glose beaucoup sur la présence d’humains dans les images d’architecture, celles de Miara sont souvent peuplées de silhouettes fugitives : « J’aime quand le projet est habité et que l’image restitue une présence. Je suis contre les mises en scène, mais la notion de passage dans le cadre, l’idée d’une architecture traversée, m’intéresse. Ce n’est pas une obligation cependant, il faut le faire si cela apporte quelque chose », termine le photographe qui prend régulièrement ses distances avec les règles du genre.
Son dernier travail porte sur la recomposition des paysages fluviaux de la zone de Cheviré, territoire de ses premiers reportages. En fusionnant deux images, il reconstitue un lieu inexistant mais vraisemblable. Utiliserait-il ce procédé sur des reportages d’architecture ? « Pourquoi pas, si cela à un sens. Je réfléchis à superposer des vues de chantiers avec des vues du projet achevé, mais le protocole est compliqué à mettre en place », dit Miara. Autre piste d’expérimentation, le retour au noir et blanc, qui a aujourd’hui complètement disparu de la photo d’architecture. « Les images des bâtiments d’Ando en béton étaient magnifiques, se rappelle-t-il. Ce qui est compliqué, c’est que les architectes nous commandent d’abord des images pour valoriser leur travail, et que la couleur est plus flatteuse de ce point de vue. » Lucien Hervé utilisait pourtant le noir et blanc. Avis aux architectes avides d’expérimentation, la monochromie est aussi un moyen de sortir du nombre !
La phrase : « Mon travail fait l’éloge de la lenteur. J’aime regarder longtemps, prendre le temps d’arpenter un site, le couvrir presque au sens physique du terme. »
Les articles récents dans Photographes
 |
Délicate et profonde, l’œuvre de Sandrine Marc couvre tout le processus photographique, de l�… [...] |
 |
En 2001, le peintre anglais David Hockney publiait un ouvrage consacré à l’usage des appareils … [...] |
 |
Le CAUE 92 de Nanterre accueille jusqu’au 16 mars 2024 une exposition intitulée «&nbs… [...] |
 |
L’école d’architecture de Nanterre, conçue en 1970 par Jacques Kalisz et Roger Salem, abandonn… [...] |
 |
Aglaia Konrad, née en 1960 à Salzbourg, est une photographe qui se consacre entièrement à l’ar… [...] |
 |
Maxime Delvaux est un jeune photographe belge, adoubé par des architectes tels que Christian Kerez,… [...] |
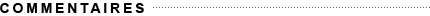
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
« En décidant de ne pas tout transformer, tout change » - Entretien avec Alexandre Chemetoff
Réutiliser, transformer, restructurer, revaloriser… autant d’actions souvent recommandées quand les enjeux de l’époque incitent à retravai… |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |
|
Quelle importance accorder au programme ? [suite]
C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |
 |