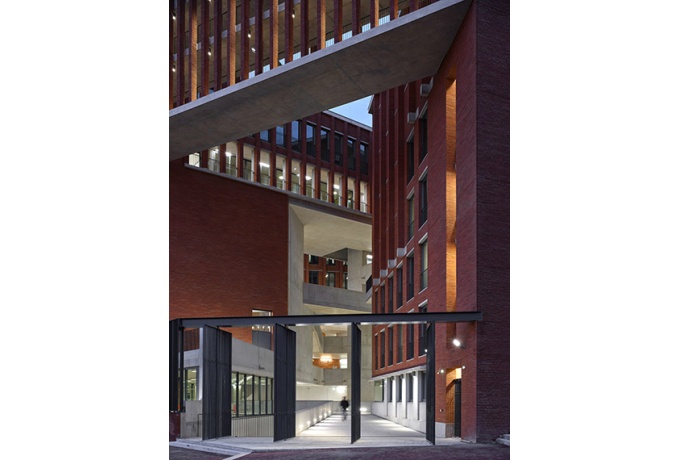
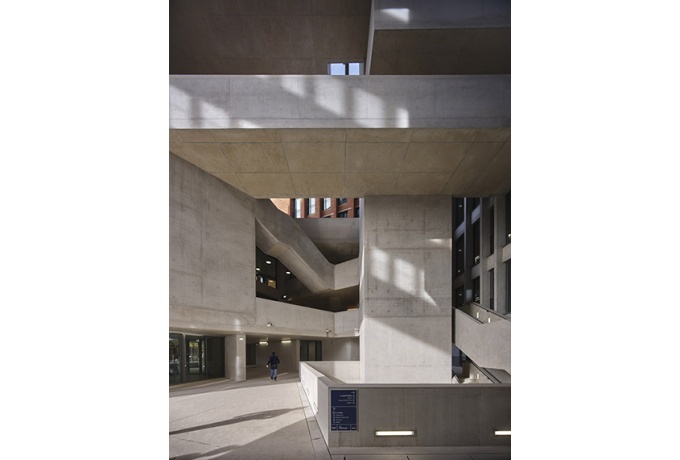


|
Architecte : Grafton Architectes Rédigé par Vincent DUCATEZ Publié le 03/03/2020 |
Fondée
par Yvonne Farrell et Shelley McNamara, les commissaires de la 16e Biennale
internationale d’architecture de Venise autour du thème de « Freespace »,
Grafton Architects s’apprête à recevoir la médaille d’or du RIBA pour leur
œuvre. L’agence livre simultanément trois bâtiments universitaires
importants : la bibliothèque de la Kingston University à Londres, leur
première réalisation britannique,
l’Institut Mines-Télécom sur le plateau de Saclay et le bâtiment des
chercheurs de la Toulouse School of Economics, leur premier projet
français. Ce dernier révèle dans un site exceptionnel la richesse conceptuelle
de Grafton Architects.
Traversant le Vieux Toulouse, dont la matérialité doit
autant à sa brique romaine rose orangée au format allongé si particulier qu’à
la massivité de ses constructions maçonnées, les pas nous mènent jusqu’à la
place Saint-Pierre. Là, en bordure de la Garonne, le paysage urbain toulousain
se trouve renforcé par les interventions de l’architecte urbaniste catalan Joan
Busquets qui, depuis 2010, préside à la redéfinition des aménagements urbains
dans une gamme très minérale. Dans la diagonale de la place, cadrée par la
masse parcimonieusement percée de l’église médiévale Saint-Pierre-des-Cuisines,
s’élève un portique mystérieux, formé d’un attique aérien, cloître suspendu de
deux niveaux, clôturant deux épais et puissants pignons de brique dont l’absence
de percements renforce le caractère monumental. Ainsi s’offre à nous le nouveau
bâtiment de l’École d’économie de Toulouse.
La genèse de cette aventure se trouve au tournant des
années 1980-1990. Jean-Jacques Laffont, décédé prématurément, et Jean Tirole,
prix Nobel d’économie, deux brillants chercheurs, familiers des pratiques
universitaires internationales, partageant leur temps entre Toulouse, Harvard
et le MIT, portent l’ambition de développer un puissant pôle de recherche à l’École
d’économie de Toulouse. Bruno Sire, alors président de l’université
Toulouse 1 Capitole, le concrétisera. Lors d’une conversation téléphonique,
celui-ci révèle les événements fondateurs du projet. Il y a d’abord le besoin
de réunir plusieurs éléments pour pouvoir attirer et surtout fidéliser des
chercheurs : des figures de pointe, un aéroport international, un cadre
accueillant pour les familles des chercheurs et un bâtiment aux standards
internationaux qui offre du confort au quotidien. Le deuxième acte est le choix
du terrain. L’université possède un terrain susceptible d’accueillir le
programme de près de 9 000 m2, mais Éric Radovitch,
architecte des Bâtiments de France, dissuade l’université d’un tel choix car la
volumétrie attendue est incompatible avec le paysage urbain. C’est alors que l’ABF pointe un terrain
triangulaire, à l’urbanité irrésolue, à la confluence de quatre monuments
historiques, appartenant au Crous et servant de parking de surface à sa
résidence universitaire voisine. Le troisième acte sera celui du concours.
Revenant de Milan où il a visité l’université Bocconi, première œuvre
internationale de Grafton Architects, Jean Tirole est persuadé qu’un concours d’ampleur
internationale doit être organisé. En effet, depuis quelques années, les écoles
d’économie commissionnent des projets architecturaux de grande qualité. Ainsi,
en plus des projets de Milan et de Toulouse, la London School of Economics
va commander successivement à O’Donnell+Tuomey, des proches de Grafton
Architects, puis à Grafton Architects des nouveaux bâtiments pendant que O’Donnell
et Tuomey livrent, au cœur de Budapest, la Central European University du
milliardaire Georges Soros. À Toulouse sont sélectionnés les architectes
toulousains de W-Architectures, dont la proposition de pierre fait écho au contraste
des bâtiments officiels de l’État dans la ville rose, les Allemands de Auer
& Weber proposant une architecture d’acier et de verre sur le registre de
la transparence, et les Dublinois de Grafton Architects avec leur forteresse de
brique. Ces derniers sont déclarés à l’unanimité lauréats du concours.
La
Plata, Dublin, Toulouse
Pour mieux comprendre le bâtiment de la TSE à la jonction d’un site, d’un
programme et d’une doctrine architecturale, il faut revenir aux fondations de l’œuvre
déjà longue de Grafton Architects. Et tout d’abord, curieusement, à la maison
Curutchet que Le Corbusier réalise à La Plata en Argentine dans les
années 1950. En 2002, on pouvait trouver chez Grafton Architects une maquette
de cette maison au milieu de celles servant à la mise au point de leur bâtiment
milanais. Ce projet, longtemps vu comme une œuvre secondaire tardive de la
période puriste, eut une fortune critique assez étonnante dans le milieu
universitaire anglo-saxon. Bernhard Hoesli, jeune architecte zurichois, fut
chargé d’en suivre la réalisation. En 1951, il enseigne à Austin, associé à
Colin Rowe et de Robert Slutzky, lors de la rédaction du texte polémique Transparency: Literal and Phenomenal.
Les auteurs y révélaient l’art raisonné et sédimenté de l’architecture dans sa
capacité à provoquer la transparence par le déploiement savant de la profondeur
de champ et non des produits verriers. C’est Bernhard Hoesli qui en réalisera
les axonométries illustratives, décomposant les projets corbuséens en plans
successifs, en écho au texte.
Sous cet éclairage, la présence a priori incongrue de
la maquette de la maison Curutchet parmi les études du Bocconi trouve son
ancrage dans le bagage théorique de Grafton Architects. Ceux-ci font partie d’un
cercle d’architectes engagés intellectuellement, dont l’émulation depuis l’orée
des années 1980 va profondément marquer la scène dublinoise en faisant la
promotion de la « critical architecture » ou « critical
practice », c’est-à-dire d’une architecture d’auteur contextualisée et fortement
ancrée dans la théorie. On y retrouve, pour ses figures les plus connues,
Yvonne Farrell et Shelley McNamara, dont les références se trouvent dans le siège
du gouvernement de Tarragona d’Alejandro de la Sota mais aussi dans la
réflexion tectonique portée par Kenneth Frampton, Shane de Blacam et John
Meagher, qui poursuivront les enseignements reçus de Louis Kahn, John Tuomey et
Sheila O’Donnell, marqués, eux, par leur proximité avec James Stirling, matinée
du critical regionalism théorisé par Frampton.
L’autre entrée pour mesurer l’œuvre de Grafton Architects
est celle de la rationalité du projet tant du point de vue structurel qu’énergétique.
Initialement confrontée aux moyens techniques limités de l’industrie du
bâtiment en Irlande, une œuvre minérale se construit progressivement. Les
projets ont en commun une volumétrie orthogonale, une palette de matériaux
choisis pour les qualités propres et supports d’assemblages sensibles, une
expressivité structurelle mesurée née d’une réflexion sur la statique et la
mise en œuvre du bâtiment, une composition des façades jouant des échelles de
perception ainsi que de l’épaisseur construite, dispositifs enrichis dès le
tournant des années 2000 d’une réflexion énergétique mettant en avant la masse
thermique des bâtiments. La troisième entrée est celle du Freespace, tel que Grafton Architects la nomme
dès leur projet milanais, où « free » signifie autant
« libre » que « gratuit ». Il s’agit de la manipulation
spatiale du programme qui permet aux architectes de dégager à moindre coût des
volumes supplémentaires pour favoriser les interactions sociales.
Une
figure de Janus
De nombreux registres du bâtiment dévoilent une réponse
attentive à un site extraordinaire. Face à l’ouest, un troisième pignon de
brique, drapé de sa monumentalité épaisse et muette, telle une tour carrée,
ancre solidement la limite du bâtiment. L’ensemble se plie autour de l’axe que
forme le pignon central et, figure de Janus, révèle un deuxième visage. Cette
fois, l’attique initial est descendu au sol, devenant la colonnade d’un socle
évidé. Ce dispositif fait ici face à l’amorce coudée et à l’alignement de
platanes majestueux du canal de Brienne. La puissante façade, dans son mutisme,
vient alors buter contre la solide enceinte médiévale formant la limite des 7 hectares
intra-muros de l’université de Toulouse. Ici un nouveau registre se
déploie : le bâtiment se coude en plan pour se mettre en retrait de l’enceinte.
La façade se perce de façon régulière de fenêtres verticales, animée par des puissants
contreforts de brique prenant naissance depuis une console musclée de béton,
encastrée dans la maçonnerie du troisième étage. La façade sud-est, longeant le
mail planté menant au cœur de l’université, s’anime d’une nouvelle
variation : se coudant également pour s’éloigner de la limite séparative,
un socle constitué des deux premiers niveaux supporte les quatre étages
supérieurs fortement striés par les voiles de brique verticaux pivotés à 45° et
soutenant un entablement de béton. Discrètement marquée par un changement de
trame de fenestration entre le socle et les niveaux hauts, la façade latérale,
avec son traitement brutaliste affirmé mais retenu, rejoint l’expression sobre
des bâtiments voisins du Crous. De l’extérieur, le bâtiment révèle graduellement
une composition selon deux axes : une organisation planaire de trois
barrettes parallèles se coudant pour rencontrer, avec leurs solides pignons,
les limites parcellaires du site en triangle, dispositif croisé par une
stratification verticale en trois bandes de deux étages chacune, reprenant un
motif aisément repérable sur de nombreux bâtiments toulousains.
L’axe de la rationalité constructive est confirmé par
Philippe O’Sullivan, l’architecte en charge du projet. La mise en œuvre de la
brique toulousaine, héritée des Romains, a requis une mise au point fournie
avec les entreprises et Terres Cuite du Saves, le fabricant local. Les parois
extérieures sont formées d’une épaisseur de brique pleine dite violette d’un
format de 42 x 10 x 5, s’élevant sur près de 25 m alors que les
joints d’expansion ou les différents accastillages structuraux sont invisibles.
Les dalles pleines dites foraines de 42 x 28 x 5, perforées pour
laisser passer un acier, forment les brise-soleil et les claustras des
escaliers. Les mulots de format 42 x 3 x 5 sont réservés aux cas
extrêmes comme l’habillage des fines suspentes des passerelles aériennes. Les
exploits structurels sont multiples quoique volontairement silencieux. Ainsi le
bâtiment cache un sous-sol profond dont les entrailles abritent l’imposante
installation technique, dont les échangeurs thermiques mettent à profit les
eaux de la Garonne pour le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment. Pour
permettre une flexibilité d’aménagement, les planchers précontraints franchissent
10,8 m, de façade à façade, formant des volumes sans structures
intérieures avec des sous-faces de dalle ininterrompues, propices à l’autorégulation
thermique par la masse du béton.
Avec la complicité du BET fluide Chapman BDSP, de
nombreuses simulations seront menées dès l’amorce du projet. Les études
aérauliques permettront de maîtriser le confort éolien des nombreuses terrasses
qui ponctuent le bâtiment. Elles serviront également à confirmer la stratégie
initiale d’évacuation incendie reposant sur des circulations très ventilées et
ne nécessitant pas l’imposition de façades accessibles aux pompiers, rendue
difficile par le site. Les études thermiques quant à elles auront deux
conséquences. S’appuyant sur la RT2005, elles permettront de définir des zones
tempérées entre l’extérieur et les zones au climat contrôlé, autorisant ainsi
une plus grande liberté de détails notamment dans le traitement d’éléments de
béton traversant des parois vitrées. Elles confirmeront également le principe
des protections solaires des vitrages qui se traduisent ici par l’épaisseur des
tableaux extérieurs et la répartition et les formes des brise-soleil. Loin d’être
le fruit d’une composition esthétique aléatoire, le dessin intuitif des façades
en trois bandes horizontales striées d’apparents contreforts s’en est trouvé
confirmé.
Le bâtiment, sous son
écorce de brique soigneusement ouvragée, révèle un monde de béton blanc aux
accents piranésiens. En parallèle à l’intégration urbaine soignée, le
déploiement Freespace climatique est ici la raison d’être du projet. Mettant en
scène l’idée de la recherche universitaire ouverte à la cité, les architectes y
formalisent une réflexion sur le confort du chercheur. Pour cela, ils vont
solliciter l’inventaire des réponses
apportées au climat toulousain, les combinant sur un registre hérité du brutalisme.
Le programme abrité est celui d’un bâtiment de bureau dédié à la recherche,
composé de près de 200 cellules individuelles avec quelques volumes collectifs
tels les six auditoriums, la cafétéria et la salle du conseil. Logiquement,
les éléments destinés à recevoir du public sont regroupés au rez-de-chaussée,
autour d’une placette triangulaire reliée à la place Saint-Pierre, dans l’axe
du portique urbain, par une longue rampe de béton. Les bureaux trouvent place,
sur huit étages, de part et d’autre de petits couloirs, dans les trois
barrettes coudées formant le plan. Le pivot en est une circulation verticale extérieure
très présente, dont la cage d’ascenseur en béton blanc perfore le bâtiment. Des
jeux de passerelles, de failles, de terrasses et de patios augmentent l’ensemble
qui se perçoit constamment en plongée et contre-plongée. La perception de cette
ode à la verticalité ne cesse de contredire la simplicité et l’efficacité du
plan. Le chercheur partage ainsi son temps entre l’intimité du confort de sa
cellule, aux fenêtres cadrant soigneusement des vues et protégées du soleil, et
un apparent labyrinthe tridimensionnel et méditerranéen, propre aux rencontres
aléatoires de la recherche transdisciplinaire.
Maîtres d'ouvrages : Universités Toulouse Capitole
Maîtres d'oeuvres : Grafton Architectes ; architecte mandataire, Vigneu Zilio,
BET fluides : CBDSP ; BET fluides local : Oteis,
Acousticien local : Gamba,
SSI : Vulcanéo,
Economiste : Gleeds,
Signalétique : Locomotion
Entreprises : ECMP, VRD, Malet, Bourdarios, Realco, Saint Eloi, Del Tedesco, ID Verde
Surface SHON : 11 280 m²
Cout : 27 millions d'euros
Date de livraison : concours 2010, début du chantier 2013, livraison décembre 2019
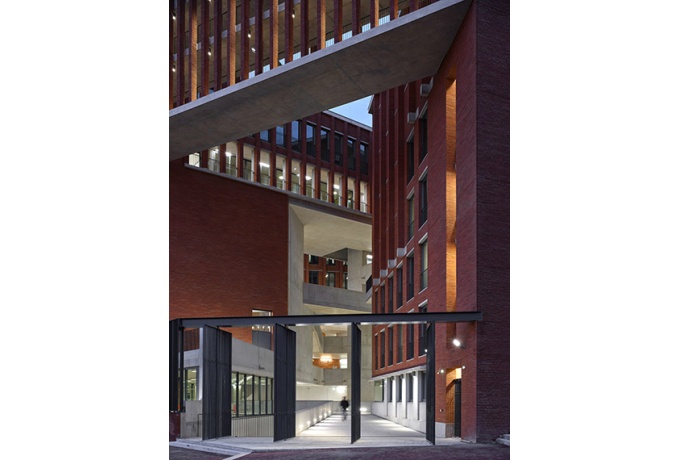
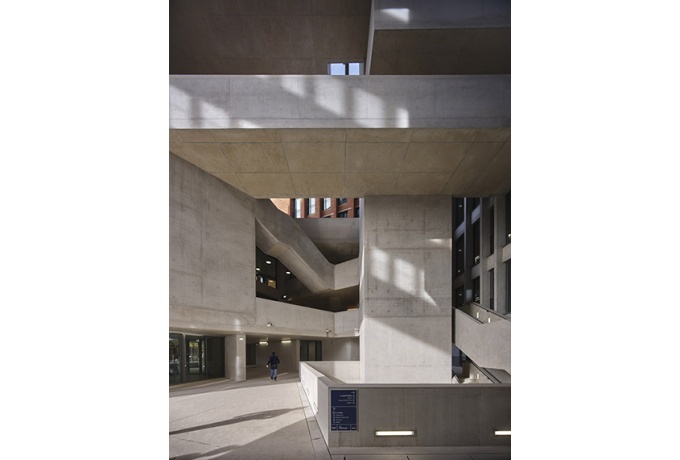


 |
[ Maître d’ouvrage : commune d’Arromanches-les-Bains Maîtres d’œuvre : Projec… [...] |
 |
[ Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Charleval-en-Provence (Yves Wigt, maire ; Christine W… [...] |
 |
[ Maîtrise d’œuvre : atelier Philippe Madec & Associés, architectes ; Stép… [...] |
 |
Maître d’ouvrage : OGICMaîtres d’œuvre : Lambert Lénack architectes (Jean-Baptis… [...] |
 |
[ Maître d’ouvrage : Fondation Nicolas Bogueret – Maître d’œuvre : Atelier Arch… [...] |
 |
Maître d’ouvrage : Groupe CIF Maîtres d’œuvre : Bourbouze & Graindorge, ar… [...] |
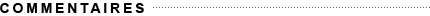
Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture publique ? 1/5
Structure des procédures, profil des équipes à monter, références à afficher, éléments de rendus…, les concours publics connaissent depuis… |
 |
|
« En décidant de ne pas tout transformer, tout change » - Entretien avec Alexandre Chemetoff
Réutiliser, transformer, restructurer, revaloriser… autant d’actions souvent recommandées quand les enjeux de l’époque incitent à retravai… |
|
Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!
Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |